
La rencontre Trump-Zelensky à Washington, influencée par un échange préalable Trump-Poutine, révèle une stratégie américaine pragmatique et déséquilibrée. Trump, focalisé sur les réalités de terrain et les intérêts économiques, marginalise l’Ukraine et l’Europe, favorisant un cessez-le-feu qui risquerait de légitimer les conquêtes russes. Zelensky, affaibli par des tensions internes et des erreurs diplomatiques, peine à défendre une position fondée sur le droit international. La perspective d’une rencontre Trump-Poutine à Budapest, sous l’égide d’Orban, accentue les divisions transatlantiques et isole davantage l’Ukraine, tout en offrant à Moscou une opportunité de dicter les termes d’un accord.
Lire la suite

 La parution de L’état du monde est toujours attendue avec impatience par tous ceux qui travaillent sur les questions internationales. Et le sujet de cette récente édition traite des nouvelles guerres. L’intérêt était donc double pour les stratégistes et spécialistes de défense. Le livre est dense avec 32 articles et notices, souvent très pertinents et documentés, rédigés exclusivement par des universitaires ou des journalistes. Une approche donc conforme aux critères et canons académiques.
La parution de L’état du monde est toujours attendue avec impatience par tous ceux qui travaillent sur les questions internationales. Et le sujet de cette récente édition traite des nouvelles guerres. L’intérêt était donc double pour les stratégistes et spécialistes de défense. Le livre est dense avec 32 articles et notices, souvent très pertinents et documentés, rédigés exclusivement par des universitaires ou des journalistes. Une approche donc conforme aux critères et canons académiques.  Si l’on choisit de commencer par une citation qui exprime la puissance de ce livre, la suivante doit être choisie : « Immense l’ambition de Staline (établir un nouveau régime politique, changer la société, développer l’économie) était moins démesurée (et moins inaccessible) que celle de Mao : créer un homme nouveau.
Si l’on choisit de commencer par une citation qui exprime la puissance de ce livre, la suivante doit être choisie : « Immense l’ambition de Staline (établir un nouveau régime politique, changer la société, développer l’économie) était moins démesurée (et moins inaccessible) que celle de Mao : créer un homme nouveau.  En Occident, les pays arabo-musulmans du pourtour méditerranéen sont victimes d’une grille de lecture schizophrénique : soit ils sont soupçonnés de se complaire dans la léthargie cultuelle de régimes autoritaires, voire totalitaires et dans le sous-développement culturel et sociopolitique qui semble caractériser « leur » XXe siècle ; soit ils sont perçus comme des vecteurs de violence sociale, de rébellions locales vite matées mais source d’insécurité régionale (Syrie) ou planétaire (Irak de Saddam), comme sont dépeints parfois les « Printemps arabes » qui agitent ces pays depuis 2011. On veut bien qu’ils évoluent, qu’ils se démocratisent, mais dans le calme et en silence. Cette grille de lecture occidentale, limitée et culturaliste, explique en grande partie les colossales erreurs d’interprétation qui caractérise souvent la diplomatie occidentale dans cette région.
En Occident, les pays arabo-musulmans du pourtour méditerranéen sont victimes d’une grille de lecture schizophrénique : soit ils sont soupçonnés de se complaire dans la léthargie cultuelle de régimes autoritaires, voire totalitaires et dans le sous-développement culturel et sociopolitique qui semble caractériser « leur » XXe siècle ; soit ils sont perçus comme des vecteurs de violence sociale, de rébellions locales vite matées mais source d’insécurité régionale (Syrie) ou planétaire (Irak de Saddam), comme sont dépeints parfois les « Printemps arabes » qui agitent ces pays depuis 2011. On veut bien qu’ils évoluent, qu’ils se démocratisent, mais dans le calme et en silence. Cette grille de lecture occidentale, limitée et culturaliste, explique en grande partie les colossales erreurs d’interprétation qui caractérise souvent la diplomatie occidentale dans cette région.  Intégration et déviance au sein du système international est le premier ouvrage de la nouvelle collection « Relations internationales » des Presses de SciencesPo dirigée par Guillaume Devin et consacrée à des travaux originaux dans ce domaine en pleine réflexion sur lui-même. Dès la préface, Bertrand Badie donne le ton : « [on] a tellement tendance à regarder les relations internationales comme un effet de puissance que d’autres entrées, plus sociologiques et souvent plus parlantes, ont été jusqu’ici négligées ».
Intégration et déviance au sein du système international est le premier ouvrage de la nouvelle collection « Relations internationales » des Presses de SciencesPo dirigée par Guillaume Devin et consacrée à des travaux originaux dans ce domaine en pleine réflexion sur lui-même. Dès la préface, Bertrand Badie donne le ton : « [on] a tellement tendance à regarder les relations internationales comme un effet de puissance que d’autres entrées, plus sociologiques et souvent plus parlantes, ont été jusqu’ici négligées ». 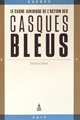 Cet ouvrage est le résultat – remanié – d’une thèse de doctorat soutenue fin 2010 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont le directeur de thèse est Jean-Marc Sorel, professeur à cette université. Ce dernier souligne le parcours singulier de l’auteure qui est macédonienne et qui a vécu la présence d’une opération de maintien de la paix. Se trouvant ensuite en France, elle a constaté, durant ses études, ce que pouvait être l’action d’un pays qui contribue d’une manière conséquente à de telles opérations. Aujourd’hui, comme ingénieur d’études, elle est responsable de projets au sein de l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (Iredies).
Cet ouvrage est le résultat – remanié – d’une thèse de doctorat soutenue fin 2010 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont le directeur de thèse est Jean-Marc Sorel, professeur à cette université. Ce dernier souligne le parcours singulier de l’auteure qui est macédonienne et qui a vécu la présence d’une opération de maintien de la paix. Se trouvant ensuite en France, elle a constaté, durant ses études, ce que pouvait être l’action d’un pays qui contribue d’une manière conséquente à de telles opérations. Aujourd’hui, comme ingénieur d’études, elle est responsable de projets au sein de l’Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (Iredies). 











136 pages