
La rencontre Trump-Zelensky à Washington, influencée par un échange préalable Trump-Poutine, révèle une stratégie américaine pragmatique et déséquilibrée. Trump, focalisé sur les réalités de terrain et les intérêts économiques, marginalise l’Ukraine et l’Europe, favorisant un cessez-le-feu qui risquerait de légitimer les conquêtes russes. Zelensky, affaibli par des tensions internes et des erreurs diplomatiques, peine à défendre une position fondée sur le droit international. La perspective d’une rencontre Trump-Poutine à Budapest, sous l’égide d’Orban, accentue les divisions transatlantiques et isole davantage l’Ukraine, tout en offrant à Moscou une opportunité de dicter les termes d’un accord.
Lire la suite

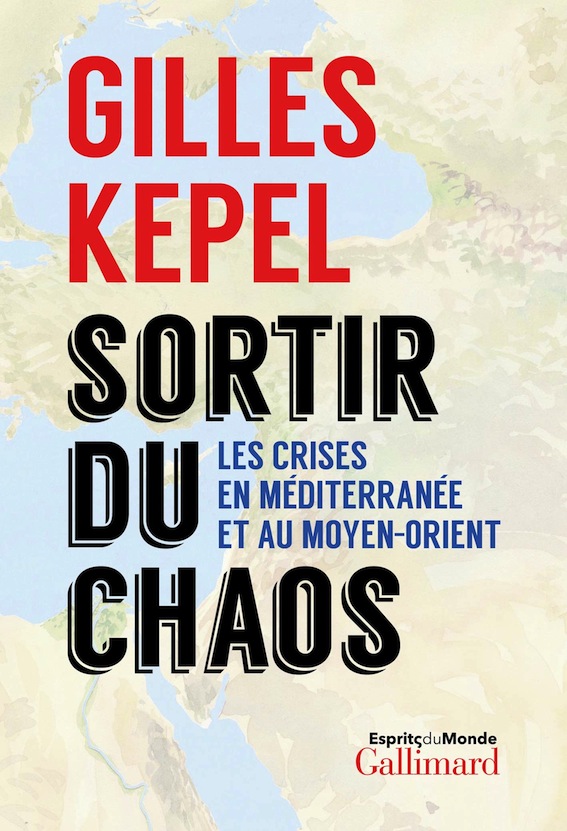 Un récit magistral servi par une réflexion percutante ! Telle est l’impression qui ressort de la lecture du nouvel opus de Gilles Kepel, fin connaisseur du Moyen-Orient et de la rive Sud. L’auteur, directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’École normale supérieure, brosse une fresque des crises et conflits qui ont ensanglanté le monde arabo-musulman de la guerre du Kippour (1973) et du premier choc pétrolier – qui marquent, selon lui, le crépuscule du nationalisme arabe et l’émergence d’un « proto-jihad » financé par l’islamisation de l’arme du pétrole – jusqu’à l’enjeu planétaire de la bataille du Levant et de l’après-Daech (2018).
Un récit magistral servi par une réflexion percutante ! Telle est l’impression qui ressort de la lecture du nouvel opus de Gilles Kepel, fin connaisseur du Moyen-Orient et de la rive Sud. L’auteur, directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’École normale supérieure, brosse une fresque des crises et conflits qui ont ensanglanté le monde arabo-musulman de la guerre du Kippour (1973) et du premier choc pétrolier – qui marquent, selon lui, le crépuscule du nationalisme arabe et l’émergence d’un « proto-jihad » financé par l’islamisation de l’arme du pétrole – jusqu’à l’enjeu planétaire de la bataille du Levant et de l’après-Daech (2018). 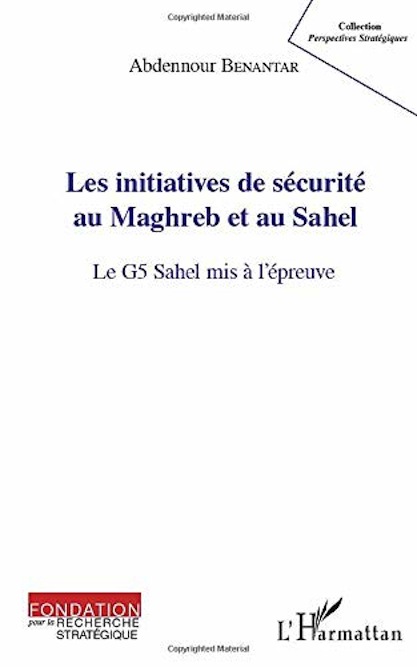 L’espace maghrébo-sahélien constitue le continuum sécuritaire des deux rives de la Méditerranée. Sa sécurisation est donc cruciale, mais problématique. C’est ce que démontre avec talent Abdennour Benantar, maître de conférences à l’université Paris 8 et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dans cet essai dense qui participe au débat stratégique sur les enjeux de la bande sahélo-saharienne. Abdennour Benantar n’en est pas à son coup d’essai, il a déjà publié deux ouvrages remarqués : La sécurité en Méditerranée occidentale et Le Moyen-Orient en quête d’un ordre régional (1945-2010), tous deux parus chez L’Harmattan en 2015.
L’espace maghrébo-sahélien constitue le continuum sécuritaire des deux rives de la Méditerranée. Sa sécurisation est donc cruciale, mais problématique. C’est ce que démontre avec talent Abdennour Benantar, maître de conférences à l’université Paris 8 et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dans cet essai dense qui participe au débat stratégique sur les enjeux de la bande sahélo-saharienne. Abdennour Benantar n’en est pas à son coup d’essai, il a déjà publié deux ouvrages remarqués : La sécurité en Méditerranée occidentale et Le Moyen-Orient en quête d’un ordre régional (1945-2010), tous deux parus chez L’Harmattan en 2015. 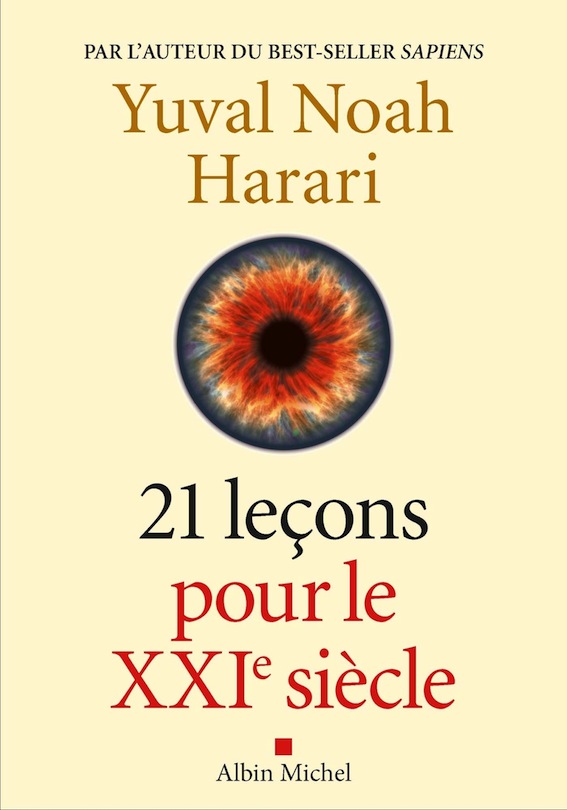 Puisque ce numéro fait référence à la mondialisation, comment ne pas évoquer le remarquable essai de Yuval Noah Harari qui décrypte l’évolution du monde et de nos sociétés en ce début de XXIe siècle. Cette réflexion à mi-chemin entre l’ouvrage de développement personnel et l’essai philosophique s’inscrit en droite ligne de ses deux précédents livres intitulés Sapiens et Homo Deus. Elle se présente comme une série de « leçons » à la mode de celles du Collège de France qui englobent chacune magistralement une problématique essentielle à nos sociétés post-modernes. Elles méritent vraiment d’être lues et relues tant elles collent aux dilemmes que se posent citoyens et dirigeants des trois rives de la Méditerranée (Nord-Sud-Est). Ces vingt-et-une leçons, d’une douzaine de pages chacune, sont regroupées en cinq parties très bien rédigées.
Puisque ce numéro fait référence à la mondialisation, comment ne pas évoquer le remarquable essai de Yuval Noah Harari qui décrypte l’évolution du monde et de nos sociétés en ce début de XXIe siècle. Cette réflexion à mi-chemin entre l’ouvrage de développement personnel et l’essai philosophique s’inscrit en droite ligne de ses deux précédents livres intitulés Sapiens et Homo Deus. Elle se présente comme une série de « leçons » à la mode de celles du Collège de France qui englobent chacune magistralement une problématique essentielle à nos sociétés post-modernes. Elles méritent vraiment d’être lues et relues tant elles collent aux dilemmes que se posent citoyens et dirigeants des trois rives de la Méditerranée (Nord-Sud-Est). Ces vingt-et-une leçons, d’une douzaine de pages chacune, sont regroupées en cinq parties très bien rédigées. 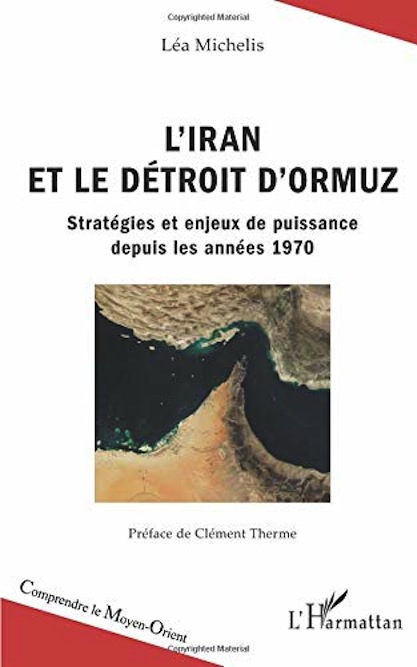 Il est rare qu’un mémoire de recherche de master 2 fasse l’objet d’une publication. Il est donc d’autant plus utile de le signaler et de le mettre en valeur quand le résultat est de qualité, ce qui est indéniablement le cas de l’ouvrage de Léa Michelis consacré au détroit d’Ormuz. Certes, le détroit d’Ormuz ne paraît pas connecté de prime abord à la thématique méditerranéenne, mais l’est pourtant par le biais de l’économie, des routes maritimes et des enjeux géopolitiques, l’Iran étant devenu un acteur du jeu méditerranéen. L’auteur, diplômée de Sciences Po Aix, a su éviter le piège du hors-sujet qui aurait constitué à ne traiter du détroit que de manière secondaire, privilégiant la géopolitique de l’Iran. Elle place au contraire ce détroit stratégique au cœur de sa problématique, décrivant cette zone et ses îles, l’analysant sous tous ses angles – notamment symbolique et économique – et montrant très bien comment elle est instrumentalisée à des fins stratégiques et politiques par l’ensemble des acteurs qui y transitent.
Il est rare qu’un mémoire de recherche de master 2 fasse l’objet d’une publication. Il est donc d’autant plus utile de le signaler et de le mettre en valeur quand le résultat est de qualité, ce qui est indéniablement le cas de l’ouvrage de Léa Michelis consacré au détroit d’Ormuz. Certes, le détroit d’Ormuz ne paraît pas connecté de prime abord à la thématique méditerranéenne, mais l’est pourtant par le biais de l’économie, des routes maritimes et des enjeux géopolitiques, l’Iran étant devenu un acteur du jeu méditerranéen. L’auteur, diplômée de Sciences Po Aix, a su éviter le piège du hors-sujet qui aurait constitué à ne traiter du détroit que de manière secondaire, privilégiant la géopolitique de l’Iran. Elle place au contraire ce détroit stratégique au cœur de sa problématique, décrivant cette zone et ses îles, l’analysant sous tous ses angles – notamment symbolique et économique – et montrant très bien comment elle est instrumentalisée à des fins stratégiques et politiques par l’ensemble des acteurs qui y transitent. 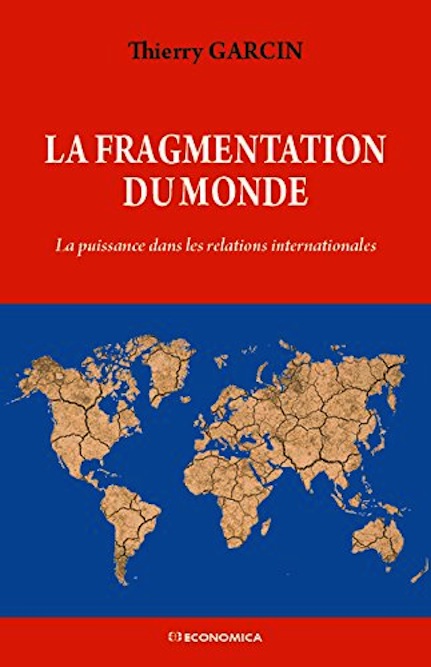 Thierry Garcin, auteur d’une dizaine de livres et autant de contributions à des ouvrages collectifs, a fait paraître cet ouvrage avec un sous-titre, « La puissance dans les relations internationales ». La valeur particulière de cette réflexion tient à la personnalité de l’auteur, à la fois journaliste et politologue. Il a animé avec talent et durant trente-trois années sur France culture l’émission « Les enjeux internationaux » dont il en a fait une référence pour quiconque s’intéresse aux affaires du monde. Mais il n’est pas « seulement » journaliste, il est aussi politologue, docteur en science politique et titulaire d’une habilitation à diriger des recherches, la fameuse « HDR » qui lui permet d’encadrer des étudiants en doctorat. Il a enseigné à l’Institut d’étude politique de Paris (Sciences Po), il est professeur invité à la Sorbonne Université Abu Dhabi et maître de conférences à HEC.
Thierry Garcin, auteur d’une dizaine de livres et autant de contributions à des ouvrages collectifs, a fait paraître cet ouvrage avec un sous-titre, « La puissance dans les relations internationales ». La valeur particulière de cette réflexion tient à la personnalité de l’auteur, à la fois journaliste et politologue. Il a animé avec talent et durant trente-trois années sur France culture l’émission « Les enjeux internationaux » dont il en a fait une référence pour quiconque s’intéresse aux affaires du monde. Mais il n’est pas « seulement » journaliste, il est aussi politologue, docteur en science politique et titulaire d’une habilitation à diriger des recherches, la fameuse « HDR » qui lui permet d’encadrer des étudiants en doctorat. Il a enseigné à l’Institut d’étude politique de Paris (Sciences Po), il est professeur invité à la Sorbonne Université Abu Dhabi et maître de conférences à HEC. 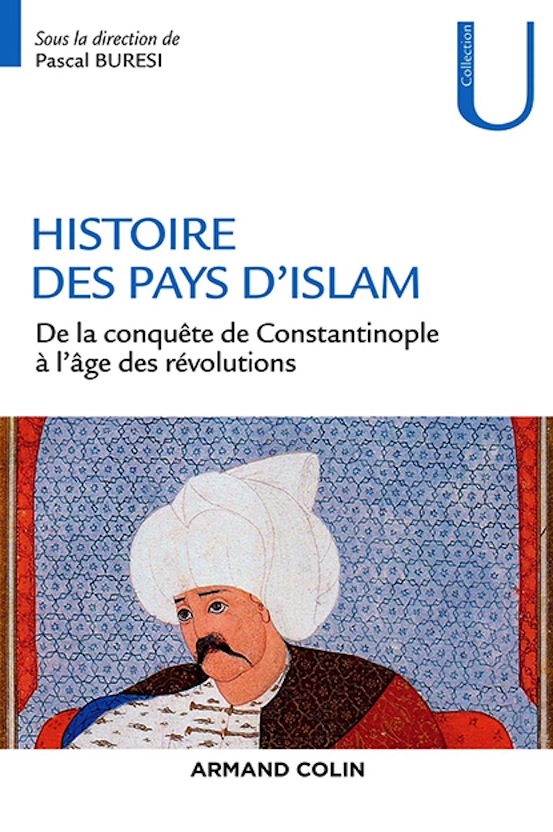 Rédiger une histoire aussi complète que possible, et largement accessible aux non spécialistes des divers mondes islamiques, n’était assurément pas chose aisée. Six auteurs, souvent issus du CNRS (en particulier de l’Institut de l’islam et des sociétés du monde musulman ou d’institutions de recherche similaires), spécialistes de chacune des grandes régions où l’islam est dominant ou significatif, ont joint leurs efforts. Leur livre s’avère une œuvre indispensable pour mieux comprendre ces mondes de l’islam à la fois si proches et si lointains qui nous occupent, nous entourent, nous interpellent de différentes façons et dont l’image est trop souvent obscurcie par les feux de l’actualité.
Rédiger une histoire aussi complète que possible, et largement accessible aux non spécialistes des divers mondes islamiques, n’était assurément pas chose aisée. Six auteurs, souvent issus du CNRS (en particulier de l’Institut de l’islam et des sociétés du monde musulman ou d’institutions de recherche similaires), spécialistes de chacune des grandes régions où l’islam est dominant ou significatif, ont joint leurs efforts. Leur livre s’avère une œuvre indispensable pour mieux comprendre ces mondes de l’islam à la fois si proches et si lointains qui nous occupent, nous entourent, nous interpellent de différentes façons et dont l’image est trop souvent obscurcie par les feux de l’actualité. 











208 pages