Revue Défense Nationale - Novembre 2014 - n° 774
La puissance en question
L’annonce le 15 octobre de la nouvelle vague de restructurations et de dissolutions à venir pour les forces françaises va se traduire par la perte de capacités opérationnelles et la suppression de 7 500 emplois. Cette diminution du format doit d’ailleurs se poursuivre d’ici 2019 selon les objectifs de la Loi de programmation militaire 2014-2019.
En une décennie, les armées auront ainsi perdu 80 000 postes et une part non négligeable de « puissance ». En effet, l’argumentaire visant à dire « moins mais mieux » se heurte désormais à la réalité des faits eux-mêmes. La notion de « puissance militaire » n’est ni abstraite ni relative. Elle ne peut pas non plus se reposer sur des discours d’auto-persuasion ou des présentations « powerpoint » masquant le concret. La puissance repose sur un ensemble complexe de capacités techniques, de ressources humaines crédibles et entraînées, d’expérience opérationnelle, de budgets cohérents et de volonté politique affirmée…
Ainsi, au « soft power » récemment revendiqué par certains États européens – plus soucieux d’économies budgétaires que des réalités stratégiques – le « hard power » est redevenu le critère de fonctionnement des relations internationales (d’ailleurs, il n’en a jamais été autrement) pour certaines puissances avides de retrouver une place comme acteurs majeurs de ce monde.
Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) affirment ainsi de nouvelles ambitions soutenues par des opinions publiques sensibles aux discours nationalistes, affamées de revanche et appuyées par des politiques militaires dopées par des budgets en hausse constante.
Ce retour du rapport de force, au sens le plus clausewitzien, mérite donc que la RDN s’y intéresse en cet automne de toutes les crises.
À travers plusieurs analyses présentées dans ce numéro, il apparaît très clairement que, si d’un côté, l’Europe désarme sciemment à tour de bras, il n’en est pas de même ailleurs où les dépenses d’armement explosent. Cela ne signifie pas nécessairement des ambitions offensives – les dissuasions nucléaires y sont pour beaucoup – mais la volonté de certains États d’éviter d’être en position de faiblesse par rapport à un environnement déstabilisateur.
Cette réalité de la puissance redevient d’actualité à peine vingt-cinq ans après la chute du mur de Berlin. Le temps des dividendes de la paix est désormais révolu, n’en déplaise à certains. Dès lors, la confrontation, entre virtualité de puissances en berne et affirmation concrète de puissances en devenir, ne peut que tourner au désavantage de ceux qui ont renoncé au « hard power ». Et il serait illusoire de croire, que « l’hiver venu », le bouclier américain sera toujours disponible pour venir au secours des « cigales ».
Jérôme Pellistrandi
Revue Défense Nationale - Novembre 2014 - n° 774
La puissance en question
La RDN vous invite dans cet espace à contribuer au « débat stratégique », vocation de la Revue. Cette contribution doit être constructive et doit viser à enrichir le débat abordé dans le dossier. C’est l’occasion d’apporter votre vision, complémentaire ou contradictoire. Vos réponses argumentées seront publiées sous votre nom après validation par la rédaction.
Aucune contribution n'a encore été apportée.





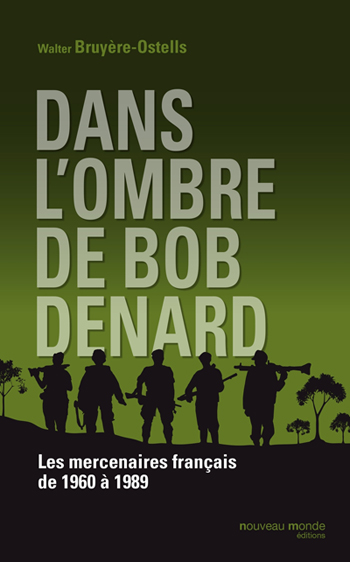 Après son Histoire des mercenaires parue chez Tallandier en 2011, Walter Bruyère-Ostells se penche plus particulièrement sur le groupe des mercenaires français dans l’Afrique postcoloniale et de la guerre froide, dont Bob Denard est la figure de proue. Outre des archives institutionnelles, il s’appuie sur les archives privées de Bob Denard et sur des entretiens avec d’anciens mercenaires ou d’autres témoins de l’époque. Le récit débute avec la sécession du Katanga en 1960, qui marque la résurgence du phénomène mercenaire et s’achève en 1989, date de la chute de la Garde présidentielle comorienne composée de « cadres » européens. Cette dernière date coïncide par ailleurs avec la fin de la guerre froide. L’ouvrage cherche à comprendre à la fois comment les mercenaires français ont pu s’imposer sur la scène africaine au cours de cette période, comment est organisé le groupe, quelles évolutions internes il connaît et quelle place est la sienne dans les relations internationales (notamment son rapport à la « Françafrique »).
Après son Histoire des mercenaires parue chez Tallandier en 2011, Walter Bruyère-Ostells se penche plus particulièrement sur le groupe des mercenaires français dans l’Afrique postcoloniale et de la guerre froide, dont Bob Denard est la figure de proue. Outre des archives institutionnelles, il s’appuie sur les archives privées de Bob Denard et sur des entretiens avec d’anciens mercenaires ou d’autres témoins de l’époque. Le récit débute avec la sécession du Katanga en 1960, qui marque la résurgence du phénomène mercenaire et s’achève en 1989, date de la chute de la Garde présidentielle comorienne composée de « cadres » européens. Cette dernière date coïncide par ailleurs avec la fin de la guerre froide. L’ouvrage cherche à comprendre à la fois comment les mercenaires français ont pu s’imposer sur la scène africaine au cours de cette période, comment est organisé le groupe, quelles évolutions internes il connaît et quelle place est la sienne dans les relations internationales (notamment son rapport à la « Françafrique »). 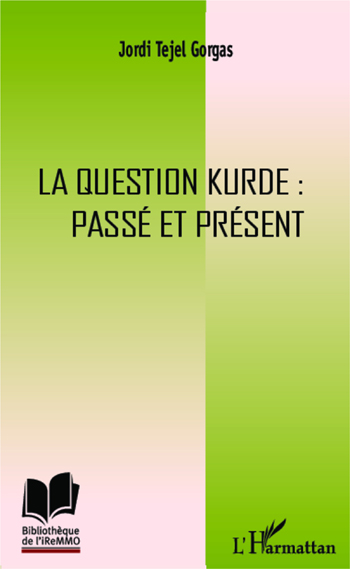 À l’heure où le Proche-Orient connaît à nouveau des jours sombres, où la question kurde émerge comme un enjeu central qui conditionne l’avenir d’une bonne partie de la région, où le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) semble manifester une vitalité militante, et militaire, et une influence renouvelées en Turquie et ailleurs, le livre de Jordi Tejel Gorgas comble, en une centaine de pages, un besoin de vulgarisation et d’actualisation de l’enjeu kurde, de plus en plus présent dans l’espace médiatique francophone, donc de plus en plus inutilement simplifié.
À l’heure où le Proche-Orient connaît à nouveau des jours sombres, où la question kurde émerge comme un enjeu central qui conditionne l’avenir d’une bonne partie de la région, où le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) semble manifester une vitalité militante, et militaire, et une influence renouvelées en Turquie et ailleurs, le livre de Jordi Tejel Gorgas comble, en une centaine de pages, un besoin de vulgarisation et d’actualisation de l’enjeu kurde, de plus en plus présent dans l’espace médiatique francophone, donc de plus en plus inutilement simplifié. 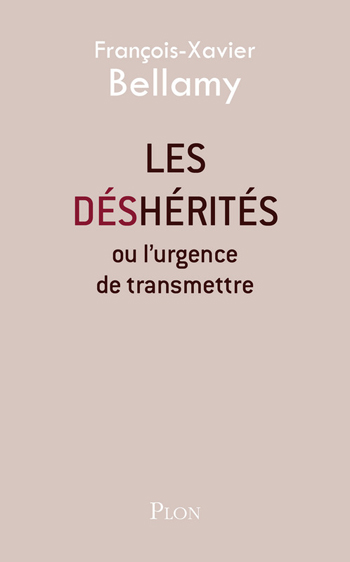 Agrégé de philosophie, François-Xavier Bellamy est un chroniqueur apprécié. Voici son premier livre, bien venu puisqu’il y fait le diagnostic de ce dont nous souffrons : le rejet de l’héritage culturel. L’ensauvagement s’en suit. À vrai dire, notre déculturation vient de loin et Bellamy dénonce les trois grands destructeurs : Descartes, Rousseau et… Bourdieu. La mise en accusation du premier surprendra. Pourtant qu’enseigne Descartes, sinon le désamour de l’école ? Que chacun doute de tout et choisisse seul sa voie ! La transmission, voilà le mal dont il faut se défaire. Rousseau en repoussoir étonnera moins. « L’heureuse ignorance », « le bon sauvage », ces mythes sympathiques ont certes mal vieilli.
Agrégé de philosophie, François-Xavier Bellamy est un chroniqueur apprécié. Voici son premier livre, bien venu puisqu’il y fait le diagnostic de ce dont nous souffrons : le rejet de l’héritage culturel. L’ensauvagement s’en suit. À vrai dire, notre déculturation vient de loin et Bellamy dénonce les trois grands destructeurs : Descartes, Rousseau et… Bourdieu. La mise en accusation du premier surprendra. Pourtant qu’enseigne Descartes, sinon le désamour de l’école ? Que chacun doute de tout et choisisse seul sa voie ! La transmission, voilà le mal dont il faut se défaire. Rousseau en repoussoir étonnera moins. « L’heureuse ignorance », « le bon sauvage », ces mythes sympathiques ont certes mal vieilli. 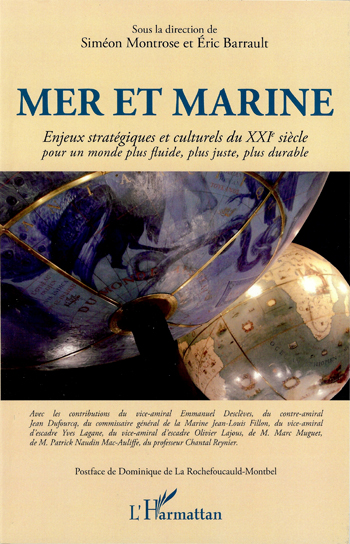 Cet ouvrage collectif puise son inspiration dans le Cahier de la RDN publié en 2011 sous le titre «
Cet ouvrage collectif puise son inspiration dans le Cahier de la RDN publié en 2011 sous le titre « 











136 pages