
La rencontre Trump-Zelensky à Washington, influencée par un échange préalable Trump-Poutine, révèle une stratégie américaine pragmatique et déséquilibrée. Trump, focalisé sur les réalités de terrain et les intérêts économiques, marginalise l’Ukraine et l’Europe, favorisant un cessez-le-feu qui risquerait de légitimer les conquêtes russes. Zelensky, affaibli par des tensions internes et des erreurs diplomatiques, peine à défendre une position fondée sur le droit international. La perspective d’une rencontre Trump-Poutine à Budapest, sous l’égide d’Orban, accentue les divisions transatlantiques et isole davantage l’Ukraine, tout en offrant à Moscou une opportunité de dicter les termes d’un accord.
Lire la suite

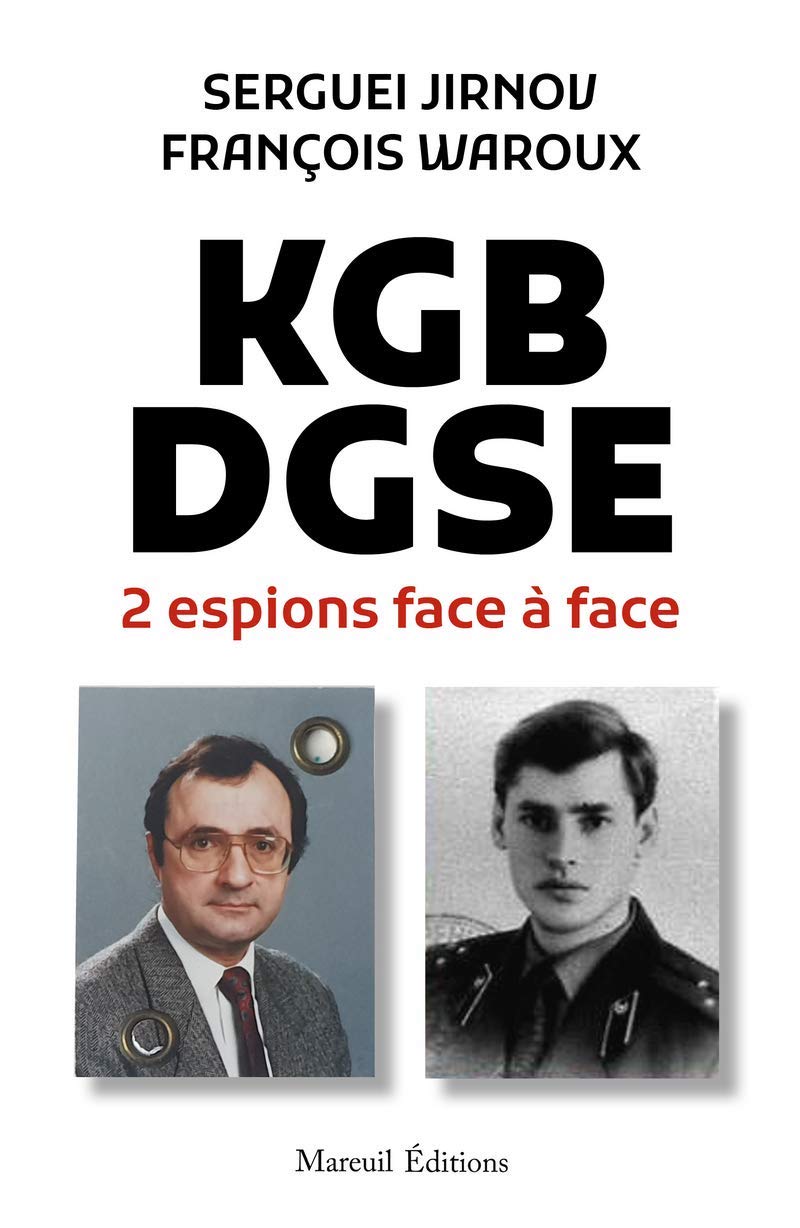 Loin de la sophistication du Bureau des Légendes, cet ouvrage, basé sur un échange très riche entre deux anciens agents, l’un russe et l’autre français, nous replonge au temps de la guerre froide puis des quelques années qui suivirent l’effondrement du bloc soviétique. D’où une certaine nostalgie d’une époque révolue. En effet, malgré le titre accrocheur, il s’agit davantage d’évoquer la période où les blocs s’opposaient que les enjeux d’aujourd’hui où, si le renseignement d’origine humaine reste essentiel, l’exploitation des données acquises par des moyens techniques et triées par l’intelligence artificielle a pris une part croissante.
Loin de la sophistication du Bureau des Légendes, cet ouvrage, basé sur un échange très riche entre deux anciens agents, l’un russe et l’autre français, nous replonge au temps de la guerre froide puis des quelques années qui suivirent l’effondrement du bloc soviétique. D’où une certaine nostalgie d’une époque révolue. En effet, malgré le titre accrocheur, il s’agit davantage d’évoquer la période où les blocs s’opposaient que les enjeux d’aujourd’hui où, si le renseignement d’origine humaine reste essentiel, l’exploitation des données acquises par des moyens techniques et triées par l’intelligence artificielle a pris une part croissante. 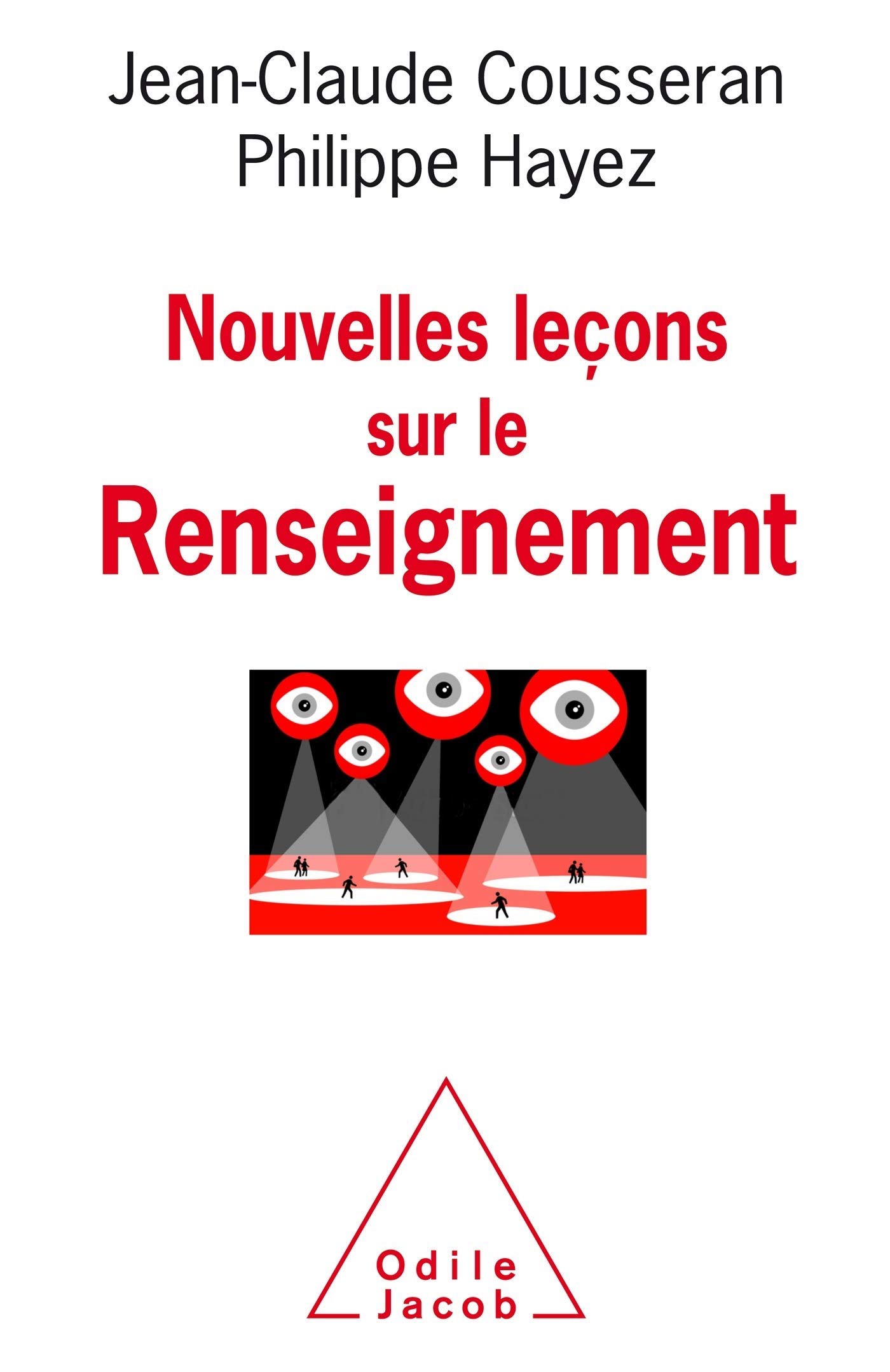 Le renseignement reste difficile à définir, voire à appréhender. Se réduit-il à toute information, passée au crible de l’évaluation et du jugement humain, qui ne peut être obtenue par des moyens « avouables » ? D’où le secret qui l’entoure et dont il doit s’entourer. Objet de nombreuses tentatives de définition, souvent obscurcies par sa dénomination anglaise (Intelligence), la notion de renseignement doit être confrontée à la conception moderne de l’information. Si cette approche permet d’en cerner le champ, elle doit être prolongée par une meilleure appréhension de sa finalité et de ses destinataires. Peut-on, dans ces conditions, s’accorder sur une définition unique du renseignement ? Doit-on évoquer aujourd’hui l’existence d’une « crise du renseignement » ? Certes, son image a changé dans l’opinion du fait de la lutte contre le terrorisme qui a rendu son travail concret et compréhensible, au point d’occulter ses autres missions qui visent à assurer la sécurité du pays, entendu au sens large ; on l’a vu avec la pandémie.
Le renseignement reste difficile à définir, voire à appréhender. Se réduit-il à toute information, passée au crible de l’évaluation et du jugement humain, qui ne peut être obtenue par des moyens « avouables » ? D’où le secret qui l’entoure et dont il doit s’entourer. Objet de nombreuses tentatives de définition, souvent obscurcies par sa dénomination anglaise (Intelligence), la notion de renseignement doit être confrontée à la conception moderne de l’information. Si cette approche permet d’en cerner le champ, elle doit être prolongée par une meilleure appréhension de sa finalité et de ses destinataires. Peut-on, dans ces conditions, s’accorder sur une définition unique du renseignement ? Doit-on évoquer aujourd’hui l’existence d’une « crise du renseignement » ? Certes, son image a changé dans l’opinion du fait de la lutte contre le terrorisme qui a rendu son travail concret et compréhensible, au point d’occulter ses autres missions qui visent à assurer la sécurité du pays, entendu au sens large ; on l’a vu avec la pandémie. 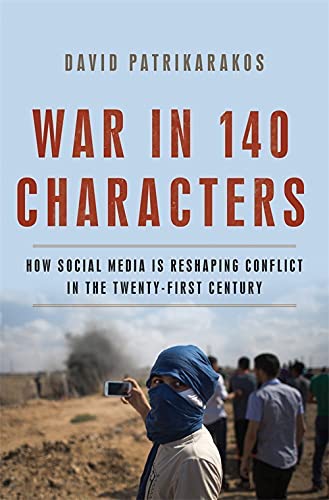 La guerre de l’information n’est pas une nouveauté, et sans doute est-elle aussi vieille que la guerre elle-même. Mais ce qui est incontestablement nouveau, c’est l’irruption des réseaux sociaux dans les procédés de la conflictualité. À tel point que, selon David Patrikarakos, c’est la forme de la guerre elle-même qui évolue sous l’effet des social medias, comme le suggère le sous-titre de son ouvrage. Ce glissement date de la décennie 2010, durant laquelle les réseaux sociaux ont permis à n’importe quel citoyen de « produire du contenu » à un coût nul, pour une audience virtuellement planétaire. Cette seule évolution vers un Homo Digitalis (c’est-à-dire monsieur tout le monde équipé d’une connexion Internet et d’un compte sur un réseau social) n’est toutefois pas suffisante pour engendrer une mue de la guerre ; mais, couplée à un contexte durable de conflits non traditionnels et à l’émergence du concept de post-vérité, la montée en puissance des social medias a provoqué un déplacement du centre de gravité de la conflictualité de leur dimension physique vers leur dimension narrative. Et dans ce mouvement, Homo Digitalis est devenu un acteur de la guerre. Un acteur sans munitions, certes, mais un acteur en possession d’un pouvoir pouvant potentiellement infléchir le cours d’un affrontement.
La guerre de l’information n’est pas une nouveauté, et sans doute est-elle aussi vieille que la guerre elle-même. Mais ce qui est incontestablement nouveau, c’est l’irruption des réseaux sociaux dans les procédés de la conflictualité. À tel point que, selon David Patrikarakos, c’est la forme de la guerre elle-même qui évolue sous l’effet des social medias, comme le suggère le sous-titre de son ouvrage. Ce glissement date de la décennie 2010, durant laquelle les réseaux sociaux ont permis à n’importe quel citoyen de « produire du contenu » à un coût nul, pour une audience virtuellement planétaire. Cette seule évolution vers un Homo Digitalis (c’est-à-dire monsieur tout le monde équipé d’une connexion Internet et d’un compte sur un réseau social) n’est toutefois pas suffisante pour engendrer une mue de la guerre ; mais, couplée à un contexte durable de conflits non traditionnels et à l’émergence du concept de post-vérité, la montée en puissance des social medias a provoqué un déplacement du centre de gravité de la conflictualité de leur dimension physique vers leur dimension narrative. Et dans ce mouvement, Homo Digitalis est devenu un acteur de la guerre. Un acteur sans munitions, certes, mais un acteur en possession d’un pouvoir pouvant potentiellement infléchir le cours d’un affrontement. 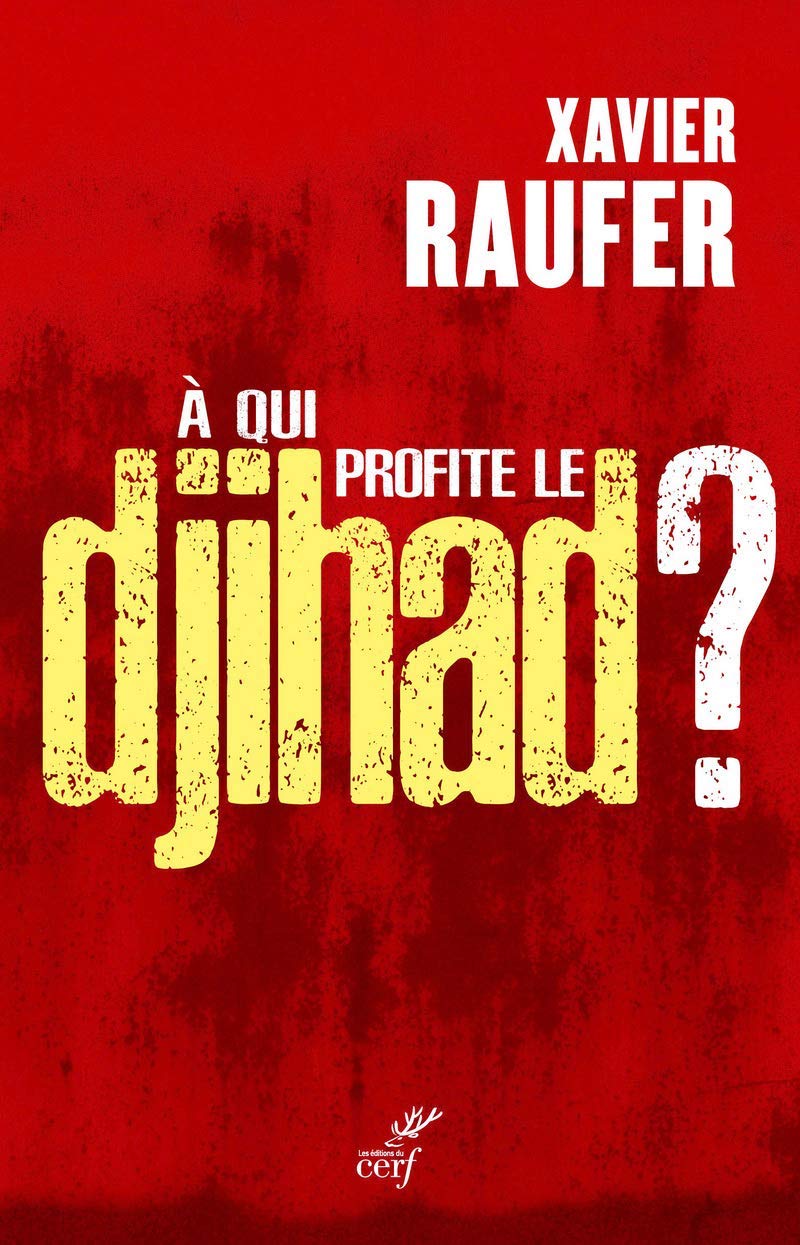 L’émergence de l’organisation qui s’est autoproclamée « État islamique » (ou plus succinctement ici EI) a donné lieu dès le début à des controverses sans fin. Née de la destruction, mal gérée, du régime de Saddam Hussein en 2003, et du licenciement des cadres du parti Baath et des membres de son armée, cette organisation a bénéficié initialement, on s’en souvient, d’une étrange mansuétude de la part de l’Administration américaine, laquelle en rendait responsable le « manque de souplesse » du gouvernement irakien à dominante chiite. Xavier Raufer ne s’inscrit pas ici dans cette ligne et ne s’intéresse guère dans son dernier ouvrage à la tolérance occidentale dont a bénéficié l’organisation, mais soutient la thèse selon laquelle l’EI aurait été aidé par le régime syrien à son début, en s’appuyant notamment sur le fait que lorsqu’elle s’engage en Syrie, il combat principalement les djihadistes du Front Al-Nosra (anciennement Al-Qaïda). Dans un livre conçu comme un « travail de déchiffrement des normes et règles stratégiques moyen-orientales » – ce qui en fait tout l’intérêt ; le spécialiste du terrorisme évoque également le rôle de l’Iran.
L’émergence de l’organisation qui s’est autoproclamée « État islamique » (ou plus succinctement ici EI) a donné lieu dès le début à des controverses sans fin. Née de la destruction, mal gérée, du régime de Saddam Hussein en 2003, et du licenciement des cadres du parti Baath et des membres de son armée, cette organisation a bénéficié initialement, on s’en souvient, d’une étrange mansuétude de la part de l’Administration américaine, laquelle en rendait responsable le « manque de souplesse » du gouvernement irakien à dominante chiite. Xavier Raufer ne s’inscrit pas ici dans cette ligne et ne s’intéresse guère dans son dernier ouvrage à la tolérance occidentale dont a bénéficié l’organisation, mais soutient la thèse selon laquelle l’EI aurait été aidé par le régime syrien à son début, en s’appuyant notamment sur le fait que lorsqu’elle s’engage en Syrie, il combat principalement les djihadistes du Front Al-Nosra (anciennement Al-Qaïda). Dans un livre conçu comme un « travail de déchiffrement des normes et règles stratégiques moyen-orientales » – ce qui en fait tout l’intérêt ; le spécialiste du terrorisme évoque également le rôle de l’Iran. 











160 pages.