
La rencontre Trump-Zelensky à Washington, influencée par un échange préalable Trump-Poutine, révèle une stratégie américaine pragmatique et déséquilibrée. Trump, focalisé sur les réalités de terrain et les intérêts économiques, marginalise l’Ukraine et l’Europe, favorisant un cessez-le-feu qui risquerait de légitimer les conquêtes russes. Zelensky, affaibli par des tensions internes et des erreurs diplomatiques, peine à défendre une position fondée sur le droit international. La perspective d’une rencontre Trump-Poutine à Budapest, sous l’égide d’Orban, accentue les divisions transatlantiques et isole davantage l’Ukraine, tout en offrant à Moscou une opportunité de dicter les termes d’un accord.
Lire la suite

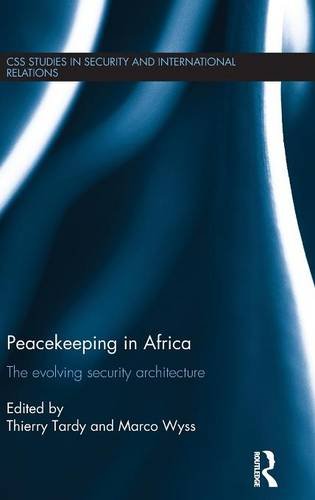 Les articles et ouvrages sur le maintien de la paix ne sont pas légion. Depuis le début des années 1990, le nombre d’articles ou d’ouvrages académiques sur le sujet se multiplie, rejoints ces dernières années par des travaux sur l’architecture de paix et de sécurité en Afrique (Apsa). L’ouvrage de Thierry Tardy et Marco Wyss s’inscrit dans cette ligne.
Les articles et ouvrages sur le maintien de la paix ne sont pas légion. Depuis le début des années 1990, le nombre d’articles ou d’ouvrages académiques sur le sujet se multiplie, rejoints ces dernières années par des travaux sur l’architecture de paix et de sécurité en Afrique (Apsa). L’ouvrage de Thierry Tardy et Marco Wyss s’inscrit dans cette ligne. 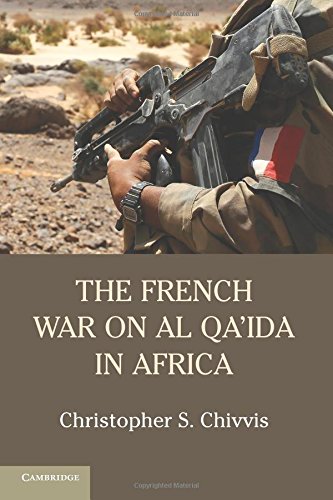 L’opération Serval a fait l’objet de plusieurs livres, dont notamment ceux du général Bernard Barrera, commandant de l’opération à Bamako (1) et de Jean-Christophe Notin (2). L’ouvrage de Christopher S. Chivvis, directeur adjoint des études de sécurité à la Rand International Security and Defense Policy Center, est destiné à un public anglo-saxon, a priori peu familier de l’Afrique et des opérations françaises. Il fait suite à deux rapports du même auteur sur la campagne de l’Otan en Libye. Dans l’un et l’autre cas, il a bénéficié d’un accès privilégié aux sources françaises, en particulier militaires et diplomates qui ont volontiers collaboré avec cet analyste hautement qualifié.
L’opération Serval a fait l’objet de plusieurs livres, dont notamment ceux du général Bernard Barrera, commandant de l’opération à Bamako (1) et de Jean-Christophe Notin (2). L’ouvrage de Christopher S. Chivvis, directeur adjoint des études de sécurité à la Rand International Security and Defense Policy Center, est destiné à un public anglo-saxon, a priori peu familier de l’Afrique et des opérations françaises. Il fait suite à deux rapports du même auteur sur la campagne de l’Otan en Libye. Dans l’un et l’autre cas, il a bénéficié d’un accès privilégié aux sources françaises, en particulier militaires et diplomates qui ont volontiers collaboré avec cet analyste hautement qualifié. 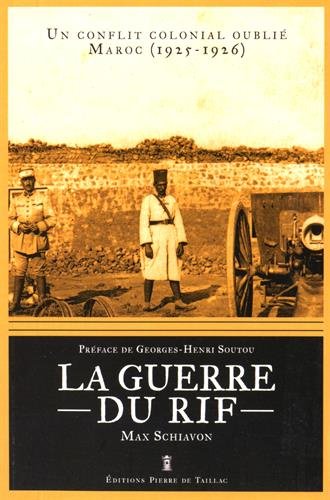 C’est une synthèse solide, étayée par un appareil critique d’une richesse exceptionnelle que nous livre l’historien Max Schiavon sur ce conflit aujourd’hui largement oublié ou relégué au rang d’épisode périphérique de la sortie de la Grande Guerre : « Qu’évoque aujourd’hui la guerre du Rif à nos compatriotes ? (…) Pourtant, à l’automne 1925, 150 000 soldats affrontent plusieurs dizaines de milliers de Rifains insurgés, sur un front de 300 kilomètres ». Le bilan humain de ce qui fut la première grande guerre coloniale moderne menée par la France est lourd : près de 10 000 morts dans le camp des Rifains, 2 500 morts côté français (dont 261 officiers) et plusieurs milliers chez les Espagnols.
C’est une synthèse solide, étayée par un appareil critique d’une richesse exceptionnelle que nous livre l’historien Max Schiavon sur ce conflit aujourd’hui largement oublié ou relégué au rang d’épisode périphérique de la sortie de la Grande Guerre : « Qu’évoque aujourd’hui la guerre du Rif à nos compatriotes ? (…) Pourtant, à l’automne 1925, 150 000 soldats affrontent plusieurs dizaines de milliers de Rifains insurgés, sur un front de 300 kilomètres ». Le bilan humain de ce qui fut la première grande guerre coloniale moderne menée par la France est lourd : près de 10 000 morts dans le camp des Rifains, 2 500 morts côté français (dont 261 officiers) et plusieurs milliers chez les Espagnols. 











204 pages