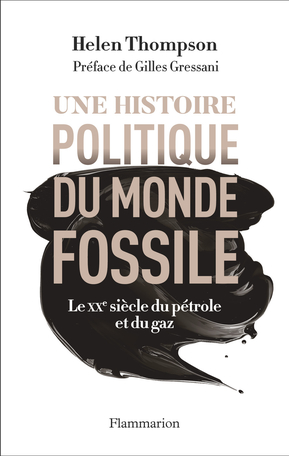
Contrairement au titre de son ouvrage, c’est beaucoup plus que l’histoire des énergies fossiles au cours du dernier siècle que brosse Helen Thompson, professeure d’économie à l’Université de Cambridge. D’abord parce que ses développements fort riches et variés, s’étirent jusqu’en 2021 à la fin de la Covid-19 et à la veille de la guerre en Ukraine. Depuis, on le sait, tant de choses se sont passées qu’il aurait été nécessaire d’ajouter tout un chapitre à son livre Une histoire politique du monde fossile, déjà bien copieux. C’était bien impossible, du fait de l’extraordinaire mobilité des événements. La seconde présidence Trump qui vient de commencer sera bien différente de celle de son prédécesseur Joe Biden et elle se traduira par des orientations distinctes sur tous les sujets qui forment la trame de cet ouvrage, à savoir les interactions entre énergie, monnaie, sécurité et démocratie.
Il est difficile de reprendre le fil de l’histoire pétrolière mondiale qu’elle décrit en mêlant pour chaque période et pour chaque acteur majeur (États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, URSS puis Russie, Chine, etc.) les données portant sur les productions, les réserves, les consommations de l’huile classique, puis de schiste. Disons pour faire court que concernant les grands pays dépourvus de pétrole ou d’accès aux réserves abondantes de Bakou, du golfe Arabo-Persique ou du Mexique, l’échec de leurs tentatives d’indépendance énergétique a été un élément peut être décisif de la fin de la domination européenne sur l’Eurasie. L’âge du pétrole n’a pas permis à l’Europe de devenir une puissance mondiale ou un empire continental. C’est d’ailleurs tout l’attrait de l’énergie verte, mais on voit les obstacles auxquels celle-ci se heurte aujourd’hui, ne serait-ce que du fait de la prépondérance chinoise dans le domaine des panneaux solaires (la moitié de l’offre mondiale), des véhicules électriques ou des méga usines de batteries électriques dont le coût se chiffre en milliards d’euros, et celui de l’énergie, de quatre à cinq fois plus élevé en Europe qu’aux États-Unis en freine le développement. Pendant des décennies avant le retour des États-Unis sur la scène pétrolière mondiale, après 1945-1947, l’Union soviétique pourvoyait à la moitié des importations de pétrole de la France et de l’Allemagne. D’où après le Pacte du Quincy, de février 1945, la volonté de Washington de faire du Golfe, la principale source d’approvisionnement du Vieux Continent afin de s’attribuer les réserves de l’hémisphère américain (États-Unis, Mexique, Venezuela) pour soi. Une politique qui a été de courte durée, du fait de la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en 1960 et l’apparition du peak oil (plafond de la production américaine en 1970). On a assisté depuis la première crise du pétrole de 1973, puis de la chute du shah d’Iran et de l’intervention soviétique en Afghanistan à une détermination américaine de plus en plus affirmée de garder son hégémonie sur le Golfe ; rôle que le Pentagone a assumé à partir de 1968 après le retrait de la Grande-Bretagne à l’est de Suez décidé par le Premier ministre travailliste Harold Wilson. Le pourcentage du pétrole dans le mix énergétique mondial ne faisait que bondir : 20 % en 1950, 27 % en 1960, 40 % en 1970, part qui s’établit aujourd’hui à 30 % contre 27 % au charbon et 24 % au gaz naturel.
Après la chute de l’URSS, l’équation pétrolière puis gazière a commencé à changer du fait que la Chine est devenue importatrice nette de pétrole en 1993. Elle deviendra ensuite la première émettrice de CO2 en 2005, le premier importateur de pétrole en 2010. Helen Thompson montre par la suite que l’année 2005 a représenté un tournant qui a largement façonné la situation énergétique et géopolitique actuelle. La seconde guerre d’Irak a fait prendre conscience à la Chine que ses importations de pétrole passant par le détroit de Malacca (80 % au total) étaient hautement vulnérables, d’où sa recherche de voies d’acheminement alternatives (corridor Pakistan-Gwadar) et sa décision de se doter d’une blue marine (marine de haute mer), qui désormais en unités dépasse celle des États-Unis, politique qui sera suivie par les Nouvelles routes de la Soie, la Belt and Road Initiative. C’est d’ailleurs en 2005 que sera prise la décision de construire un oléoduc Sibérie-Chine et de procéder aux premiers exercices militaires avec la Russie – orientation qui ne fera que se renforcer après l’annexion de la Crimée et surtout la guerre d’Ukraine. En 2005, l’Allemagne entrait dans l’ère des grandes coalitions et lançait le chantier de Nord Stream I, dont le second tuyau fera l’objet de sanctions américaines en 2019, sous la présidence Trump, Joe Biden les lèvera en mai 2021… Déjà, on entendait le grondement des chars autour de l’Ukraine et un nouveau chapitre, d’une tout autre ampleur, débutait. Si l’Allemagne, et l’Europe peuvent être considérées comme les perdantes de la situation actuelle, on ne peut en dire autant de la Turquie qui, avec Turkstream, est devenue depuis le 1er janvier 2025, le seul canal d’approvisionnement du gaz européen, par gazoduc.
Si on prédisait naguère la fin du pétrole, l’avènement de l’âge d’or du gaz et la disparition du charbon, la part des énergies fossiles – 81 % de la consommation mondiale – n’a baissé que de 5 % par rapport à 1979. Si commence la bataille des métaux stratégiques et des terres rares, il n’en demeure pas moins que l’énergie sera nécessaire pour les extraire, les transporter, les raffiner, les distribuer. L’échiquier énergétique est de plus en plus influencé par la géopolitique ; ses liens avec la monnaie, la sécurité et la démocratie restent en place et soumis à bien des soubresauts. ♦








