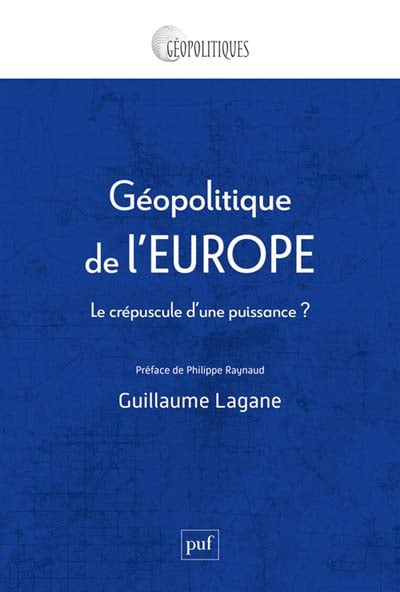
Voilà plus d’un siècle que l’on réfléchit, débat, argumente sur le déclin de l’Europe que Paul Valéry avait défini en 1919, dans La Crise de l’esprit, comme « un petit cap du continent asiatique ». Cette fois-ci cependant l’Europe, théâtre d’une nouvelle guerre qu’elle n’a ni voulu, ni pu empêcher et à laquelle elle ne peut seule mettre fin, affronte des défis sans précédent. Sa croyance dans la règle, le multilatéralisme, la suprématie du droit international est fragilisée par le retour des politiques de puissance, le choix délibéré d’une politique protectionniste agressive par son protecteur américain qui désire de moins en moins assurer sa protection ou lui faire payer. À la suite de Paul Valéry, qui avait écrit que nous savons désormais que les civilisations sont mortelles, nous savons désormais que la construction européenne l’est également. Nous voilà avertis.
La liste des défis qui nous menacent est bien longue et il paraît inutile d’y revenir. Arrêtons-nous un instant sur sa pensée première. Une civilisation qui meurt, ne peut plus renaître semble-t-il, alors que toute construction politique est, par nature, plus passagère et éphémère, et donc ce qui a été détruit « par les hommes peut un jour être reconstruit par eux ». Tout dépend ce que nous – quel est ce nous ? – entendons par Europe. La relative cacophonie qui a marqué les élections européennes de juin 2024 montre bien que le consensus qui régna en Europe depuis les années 1950 n’est plus. C’est donc toute la stratégie économique, industrielle, commerciale, technologique et militaire qui doit être repensée. Cependant, comme le montre l’auteur, les divisions européennes, la concurrence implacable de la Chine, les revendications du « Sud global » rendent le sursaut difficile. Pour preuve, plus d’un an après la publication du rapport Draghi, qui préconisait en mesure phare un investissement annuel de 800 milliards d’euros pour parvenir à l’autonomie technologique et énergétique, seuls 10 % de ses recommandations ont été mises en œuvre.
Pourtant l’Europe apparaît plus unie que ne le sont les autres continents : Asie, Amérique, Afrique. Bien que soumise à une baisse démographique préoccupante, au poids excessif de dépenses sociales, et au moment où elle s’est engagée à consacrer 3,5 % de son PIB à la défense, elle peut encore puiser dans ses ressources et son capital humain. Si tout ou partie des quelque 320 Mds € qui s’investissent chaque année aux États-Unis restait sur le continent, l’Europe enclencherait une dynamique vertueuse. Pour éviter à l’Europe, de s’effondrer ou tout simplement de ne plus exister en se délitant, se fragmentant ou en se montrant incapable de prendre des décisions souveraines par rapport aux États-Unis et la Chine, il convient, argumente-t-il, de bâtir un nouvel édifice européen. Cette tâche, seule bien entendu la France peut l’accomplir, en symbiose – note-t-il au passage – avec l’Allemagne. Peu importe si une controverse « constructive » vient de s’installer au sein du couple franco-allemand qui a toujours servi de socle à la construction européenne. On admirera le volontarisme de sa pensée et le courage de son action. Il est vrai qu’il peut se targuer de quelques avancées en matière de renforcement de la zone euro, de garanties plus solides dans le domaine bancaire, d’un embryon de budget de la zone euro, d’un plan en matière de batteries électriques si important pour assurer l’avenir de la branche automobile vitale pour l’Allemagne et la France. Il lui faut abandonner son projet fédéral – un des scénarios d’avenir qu’esquisse l’auteur –, pour se concentrer comme l’avait dit Jean Monnet sur des solidarités de fait. Un sursaut reste possible. Les signes d’espoir demeurent comme l’ont indiqué les élections en Moldavie, l’Union européenne reste attractive, au vu des candidats aspirant à la rejoindre. Néanmois, elle devrait réformer ses structures, simplifier ses procédures de prise de décision et former plus franchement des groupes de pays pionniers. ♦




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)



