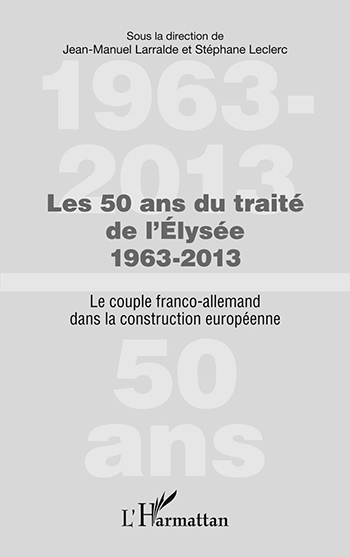
Au moment où le couple franco-allemand semble traverser un nouveau trou d’air, comme l’a montré la manière dont, aux yeux de Paris, Angela Merkel a négocié personnellement, en direct l’accord avec la Turquie sur l’accueil et le renvoi des migrants, il est plus que nécessaire de se pencher sur les rapports franco-allemands, qui depuis l’origine a toujours été considérée comme le fondement essentiel du muet de l’unification européenne.
Le lecteur ne manquera de s’écrier encore un livre sur la coopération franco-allemande. Lui dresse-t-on une nouvelle stèle ou érige-t-on sa stèle funéraire ? Patience, le sujet semble inépuisable et donne lieu à bien des imprévus, à défaut de miracles !
Au départ, on le sait, il s’agissait de sceller la réconciliation entre les deux pays, dont le terme en allemand (Versöhnung) mérite quelque explication, car il décrit une forme spécifique de relations sociales qui ne se fondent pas exclusivement sur celles qui lient les individus, mais qui caractérise aussi les relations entre deux ou plusieurs sociétés. Mais elle suggère aussi, tant sur le plan personnel que politique, un désir de paix, et de ce fait est ancrée dans les imaginaires. On peut désormais, considérer ce processus achevé. La poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl, le 11 novembre 1984 à Verdun en fut le dernier symbole le plus éclatant. Le couple franco-allemand, expression journalistique récupérée par les hommes politiques, mais que d’autres métaphores sont aussi employées, tandem, moteur, puisque l’on semble plus employer l’expression d’amitié, pour vivre et exister passe par toute une série de rencontres, d’instances de coopération, ainsi que d’une série de comités, de commissions allant des traditionnels Sommets biannuels aux comités conjoints, en matière de défense, de coopération économique et financière, sans parler de la coopération en matière de jeunesse que met en œuvre l’Ofaj (Office franco-allemand de la jeunesse), dont l’action est passée en revue en détail. S’agit-il d’empiler de nouvelles instances, ou plutôt de les simplifier : tout dépend de ce que l’on aime tant désigner de volonté politique.
On trouvera donc dans cet utile synthèse, avec des références bibliographiques très largement allemande (y a-t-il un retard de la réflexion française dans ce domaine aussi) une description minutieuse de la conjoncture internationale au sein de laquelle a été signé le Traité de l’Élysée, le 22 janvier 1963, au lendemain de la crise des missiles de Cuba, d’octobre 1962 et du non du général de Gaulle à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE, en date du 14 janvier 1963. N’oublions pas qu’alors le chef d’État français voulait créer un espace de coopération, plus ou moins indépendant au sein des structures agnatiques, d’où son vœu d’étendre la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense, objectif qui n’a pas manqué d’être critiqué par Washington, mais est resté incompris à Moscou. Force est ce dire qu’en dehors de la brigade franco-allemande, ou d’autres instances de coopération, le domaine de la défense et de la sécurité n’a pas donné lieu à des percées décisives, comme ce fut le cas avec la Grande-Bretagne par les accords de Saint-Malo et de Lancaster House.
Mais les auteurs ne s’en tiennent pas à la description des mécanismes de la coopération franco-allemande, telle que celle-ci est mise en œuvre par les responsables politiques et les diplomates des deux pays (on trouvera une description très vivante et illustrée de l’action des principaux ambassadeurs français à Bonn, puis à Berlin des années 1960 aux années 2000 à force d’entretiens ou même de reprises de leurs documents privés). Ils s’attaquent à ce qui constitue la grande question de leurs rapports économiques et monétaires. On a assisté depuis 2000 à l’élargissement du fossé de leurs performances dans tous les domaines, commerce extérieur, chômage, stabilité budgétaire, compétitivité. Malgré d’indéniables progrès réalisés en matière de gouvernance économique, bien des malentendus subsistent. Les observateurs attendent toujours le pacte politique fondateur annoncé tant de fois à haute voix par Paris et Berlin, qui a peu de chances de voir le jour avant 2017. Il n’y a pas de politique commune en matière d’énergie. D’où les craintes allemandes récurrentes pour la France, considérée comme le maillon faible de l’Union. Selon le classement annuel du Forum économique mondial de Davos, la France a reculé de la 15e à la 23e place en 2013, en termes de productivité, alors que l’Allemagne est au 4e rang, qui malgré 23 milliards d’euros de dépenses supplémentaires destinées à l’écueil des migrants viennent d’adopter un budget équilibré pour la troisième année consécutive.
Qu’en conclure ? Faut-il se borner à plagier Voltaire qui disait que si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer, si la coopération franco-allemande n’existait pas, il faudrait l’inventer, ou plutôt la réinventer. Dispose-t-on de forgerons de la taille de Vulcain ? À l’heure des menaces réelles d’un Brexit, des divergences croissantes à l’intérieur de l’éditique européen entre l’Ouest et l’Est, le Nord et le sud, le couple franco-allemand se trouve au cœur du dispositif, le dernier pilier stable, ce paquebot a essuyé bien des tempêtes, dont celle de la réunification allemande et saura traverser les remous actuels.




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)



