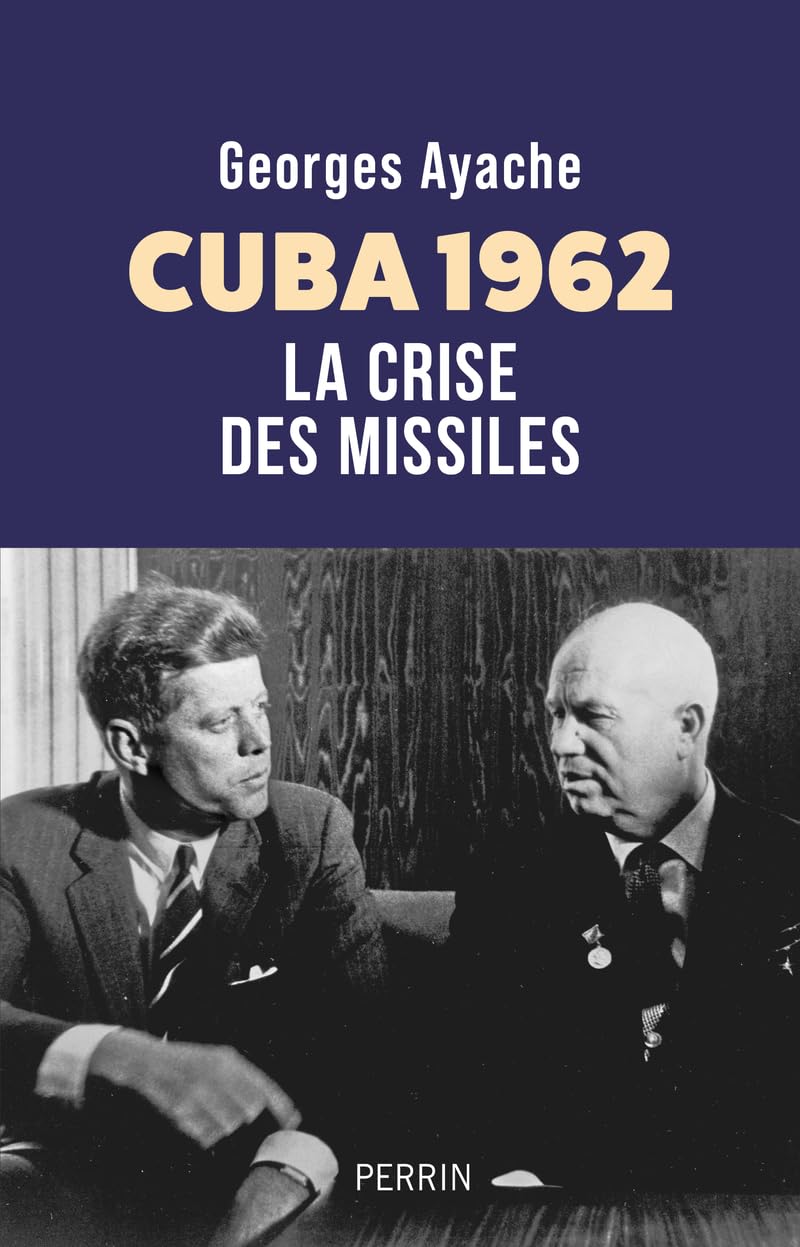
Ancien diplomate, avocat et auteur prolixe qui s’est spécialisé sur les États-Unis, dont il a exploré bien des événements marquants et brossé le portrait de maints de ses leaders, Georges Ayache s’est attaqué avec ardeur et érudition à un sujet tellement labouré. On croyait ne plus rien avoir à apprendre sur ce dernier et ultime spasme de la guerre froide, qui a inauguré une ère de détente, que l’on examine aujourd’hui avec nostalgie. Outre qu’il est toujours stimulant de jeter un coup d’œil actuel, débarrassé des préjugés de son époque, sur n’importe quel épisode historique de poids, l’intérêt d’un tel sujet saute aux yeux. À chaque fois que le président russe Vladimir Poutine, dès fin février 2022, a brandi la menace nucléaire, le monde n’a-t-il pas tressailli en se remémorant la crise des missiles que les Cubains appellent « crise d’Octobre » et les Soviétiques « crise Caraïbes » ? L’inamovible ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov n’a-t-il pas évoqué, pour sa part, la possibilité pour la Russie, d’installer de nouveau des missiles à Cuba, dans l’éventualité bien hypothétique d’une entrée de l’Ukraine dans l’Otan, celle-ci y déposerait des missiles à moyenne portée capables d’atteindre Moscou en une dizaine de minutes !
Bien des ouvrages récents se sont penchés à nouveau sur cette crise des missiles, l’immense majorité provenant d’experts américains. De plus, les enregistrements effectués à la demande du président Kennedy, lors des séances souvent tendues de l’EXCOM, émanation du Conseil national de sécurité, aréopage de la douzaine de responsables qui ont géré la crise durant ces treize jours du dimanche 14 octobre au dimanche 28 octobre 1962 ont été divulgués. Tous ces matériaux, témoignages, évaluations, critiques ont été scrutés par Georges Ayache qui les restitue avec le talent d’un conteur et le sérieux d’un fin analyste des relations internationales. Son gros ouvrage comprend une chronologie, quelques cartes et une longue présentation – cela va de soi – du contexte cubain, du caractère et de la psychologie des deux « K », qui s’étaient réunis brièvement à Vienne début juin 1961, sans s’être alors trouvés. L’issue de la crise des missiles aurait pu instaurer entre eux une sorte de lune de miel, mais tous deux quittèrent la scène en 1963 et 1964, et seul Fidel Castro, qui, fidèle à sa réputation de trublion, s’était insurgé sur la mollesse des camarades soviétiques, resta aux commandes jusqu’en 2008. La véritable et brève détente, celle qui rapprocha Nixon et Brejnev, n’intervint qu’en 1972 (avec la signature des accords SALT et ABM) et 1973 (accord du 22 juin sur la prévention de la guerre nucléaire) avant que la guerre d’octobre 1973 (guerre du Kippour) ne porte un coup à ce rapprochement soviéto-américain.
On trouvera dans ce livre un tableau très fouillé du déroulement de la crise du comportement des principaux acteurs des deux côtés, soit une trentaine de personnes dont la plupart sont entrés dans l’histoire. Georges Ayache décrit dans le détail la conclusion qui, on le sait, s’est achevée par un accord gardé secret selon lequel en échange du retrait des 42 missiles à moyenne portée (MRBM), John F. Kennedy s’engageait à ne plus attaquer l’île et renonçait aux fusées Jupiter installées en 1961 en Italie et en Turquie, que le Pentagone jugeait bon de déclarer obsolète. De plus élément moins connu, Nikita Khrouchtchev s’engagea, sans s’être vraiment fait forcer la main, à retirer la centaine de missiles tactiques et les bombardiers Iliouchine 28. Il ne s’agissait pas de petites munitions, leur charge était cent fois celle de Little Boy de Hiroshima et selon Graham Alisson, le grand spécialiste américain qui a produit la première étude approfondie de la crise, elles auraient pu causer la mort de 100 millions de personnes aux États-Unis, un chiffre qui apparaît stupéfiant. Au final, le bilan n’a pas été aussi catastrophique pour le leader soviétique que cela paraissait puisqu’au printemps 1963, il ne restait plus aucun missile stratégique américain en Europe de l’Ouest. Une quinzaine d’années plus tard, cela a déclenché chez les Européens la peur du découplage et la crise des Euromissiles qui envenima les relations Est-Ouest jusqu’à 1987 du fait de l’arrivée de Gorbatchev au Kremlin, disposé à mettre un terme définitif à l’affrontement Est-Ouest, estimant sur ce point qu’il menait à son terme l’œuvre de Khrouchtchev.
Georges Ayache décrit beaucoup de faits, se livre à de nombreuses analyses dans son livre qui donne une vision rajeunie de la crise des missiles, dont les enseignements restent si actuels. Car tout repose sur le caractère des leaders suprêmes, de leur claire évaluation des rapports de force, de la rapidité et de la précision de leurs décisions et proclamations. Sur ce point, l’épreuve de la crise a été impitoyable pour bien des responsables et il est utile de savoir pourquoi. On peut se demander si tous ses jugements sont toujours exacts, lorsqu’il écrit que rares sont les guerres authentiquement intentionnelles. Si cela est tout à fait juste pour la Première Guerre mondiale, le déclenchement de la Seconde n’est-il pas dû à un seul homme : Hitler ? Ne peut-on pas en dire autant, toutes proportions gardées, de la guerre d’Ukraine, sans parler des deux guerres du Golfe, de la seconde surtout déclenchée par George Bush fils.
Au final, Georges Ayache estime que la Détente qui a succédé à la crise des missiles et qui s’est traduite au plan symbolique par l’installation de la hot line le 20 juin 1963, n’était ni la paix ni la coexistence pacifique. Or, celle-ci dans la doxa date de 1956, après la mort de Staline, lorsqu’après le dégel, les deux Grands ont renoncé à vouloir obtenir un regime change par la force, même si cette bonne intention a connu bien des entorses comme les crises de Berlin (1948 et 1961). La détente, elle, est qualitativement supérieure, car elle a conduit les deux Grands à entamer un long cycle de contrôle des armements (arms control) en instaurant un système de sécurité européen et mondial, qui fut démantelé au cours du dernier quart de siècle. Certes, comparaison n’est pas raison et on ne se baigne jamais dans la même eau, mais comme Munich (1938), la crise des missiles est restée gravée dans la mémoire collective. La part de l’homme reste décisive dans la gestion des crises et on doit espérer que l’Intelligence artificielle (IA), même si celle-ci peut apporter des éléments utiles d’analyse, ne viendra pas supplanter le véritable homme d’État. ♦



_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)




