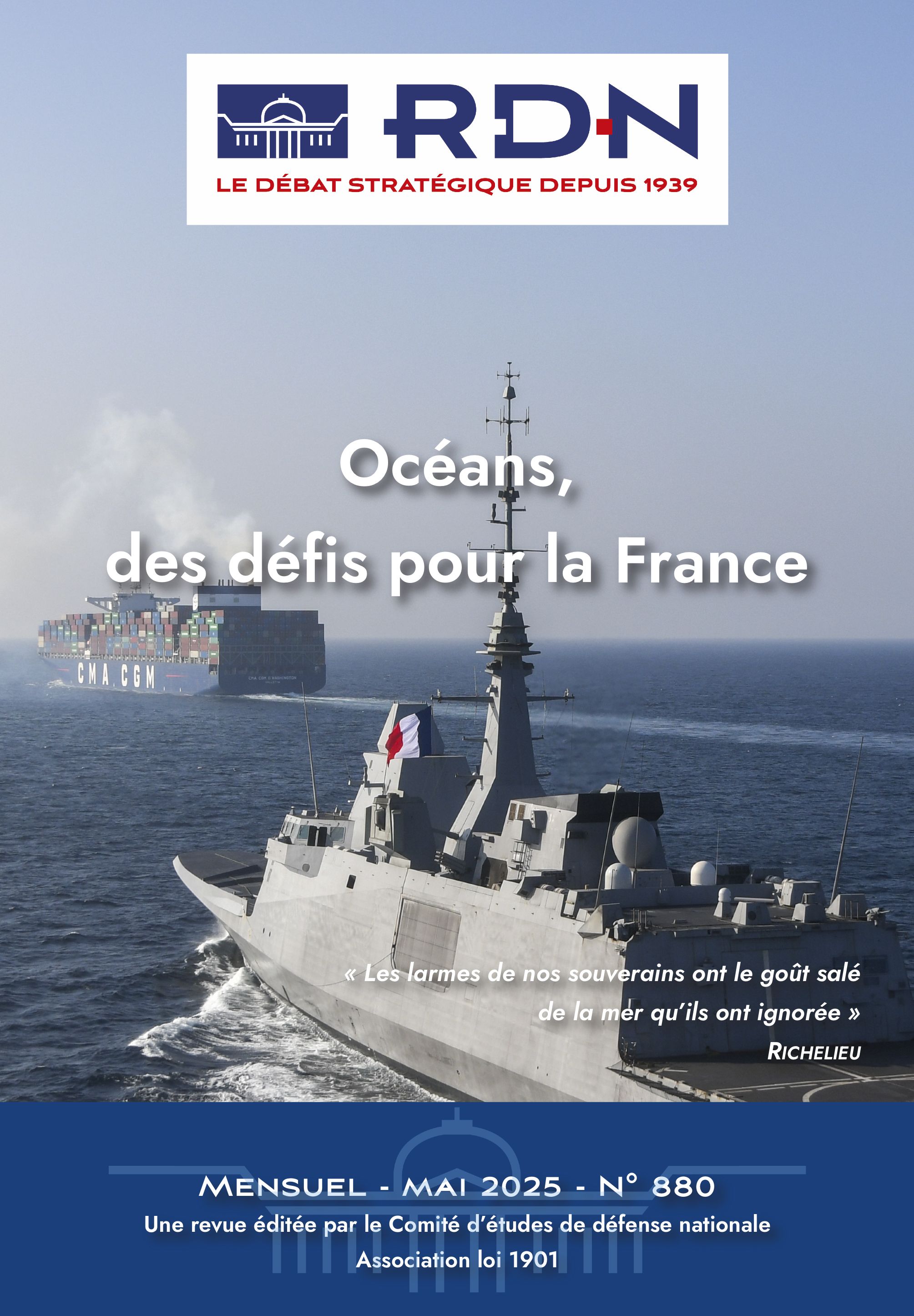L’auteur donne ici ses impressions personnelles d’envoyé spécial du journal Le Monde pendant diverses opérations militaires françaises en Afrique noire dans les années 1970-1990, opérations que la RDN a souvent abordées dans ses chroniques militaires ou « Outre-mer ».
Témoignage : 1970-1990, une armée française hardie en Afrique noire (T 1435)

Note préliminaire : L’auteur donne ici ses impressions personnelles d’envoyé spécial du journal Le Monde pendant diverses opérations militaires françaises en Afrique noire, opérations qu’il a évoquées dans Le Fous d’Afrique (Seuil, 2001) et L’Afrique en 100 questions (Tallandier, 2021, avec Stephen Smith). À noter que les opérations citées dans cet article ont souvent été abordées dans les chroniques militaires ou « Outre-mer » de la RDN et sont à retrouver sur notre site Internet.
À l’heure où la France est en mauvaise posture au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso et autres pays africains ouverts à la milice russe Wagner, dans un contexte d’affrontement entre la Russie et l’Occident, il sonne douloureusement le constat osé en 1976 par Louis de Guiringaud, ministre des Affaires étrangères : « L’Afrique est le seul continent qui soit encore à la mesure de la France, à la portée de ses moyens. Le seul où elle peut encore, avec 500 hommes, changer le cours de l’histoire. » Même si le pouvoir politique la mettait parfois au service de présidents contestables, l’armée française fut une armée hardie en Afrique noire, sans états d’âme, satisfaite de ses missions et de ses moyens pendant deux décennies, de 1970 à 1990. Tel était du moins le sentiment d’un journaliste qui couvrait ses opérations au Tchad, en Centrafrique, au Togo et au Gabon.
* * *
Le 21 janvier 1971, le sergent-chef Bertrand Cortadellas, fils du général Édouard Cortadellas, « délégué du gouvernement français auprès du président de la République du Tchad et commandant en chef des forces franco-tchadiennes », trouve la mort dans ce pays. Une opération héliportée, menée dans le Borkou par une compagnie de parachutistes d’infanterie de marine, a rencontré une vive résistance et, sans le savoir, un rebelle a pris pour cible un homme dont la perte était hautement symbolique. Donnant un bel exemple de stoïcisme militaire, le général Cortadellas me reçoit quelques jours après pour « un point de situation » pendant lequel il manifeste une espèce de respect personnel pour le Derdeï, le chef des « dissidents » toubous combattus par son fils. « S’il faisait le moindre signe en vue de négociations, j’arrêterais les opérations tout de suite ».
La guerre ne s’arrêta pas dans le « BET », l’abréviation désignant le Borkou, l’Ennedi et le Tibesti, ces provinces du nord sous administration française, qui n’avaient été rattachées au Tchad qu’en 1966, plusieurs années après l’indépendance. Le « Dernier quart d’heure au Tchad ? » – titre d’un reportage que j’avais prudemment fait suivre d’un point d’interrogation en 1971 – sera long, entrecoupé de retraits et de retours du corps expéditionnaire français en fonction des humeurs changeantes des Présidents tchadiens, mais il comprendra des moments de bonheur et d’exaltation militaire, faits d’admiration pour certains chefs de guerre tchadiens et de sensations mémorables dans les « paysages magnifiques » du Tibesti, si l’on peut trouver beaux des paysages où des hommes s’entretuent.
En 1969, une des dernières décisions du général de Gaulle, avant de quitter le pouvoir, avait été d’accorder une aide déterminante à François Tombalbaye, premier Président du Tchad indépendant. En quelques semaines, 3 000 hommes avaient pris le chemin de Fort-Lamy, presque la moitié des effectifs de l’armée tchadienne… dans laquelle il y avait déjà 630 officiers et sous-officiers servant au titre de la coopération. Cependant, les Saras de la garde personnelle de Tombalbaye ont été impuissants contre le putsch de 1975 : Tombalbaye est tombé sous les balles de l’« armée nationale » et le général Félix Malloum l’a remplacé à la présidence de la République. À la demande de celui-ci, l’infanterie française, bénéficiant d’un appui aérien, a stoppé une offensive de rebelles accompagnés de « conseillers » libyens en mai 1978. Mais le même général Malloum a fui le Tchad en février 1979, après qu’une guerre de rues a opposé ses partisans à ceux de son rival Hissène Habré dans Fort-Lamy rebaptisé N’Djamena. Finalement, un troisième homme, Goukouni Oueddei, soutenu par les Libyens, a conquis le pouvoir. Il est le chef d’un « Gouvernement d’union nationale de transition », le Gunt, dans un pays dont les militaires français, par décision élyséenne, se sont retirés en avril 1980, le laissant au chaos.
En octobre 1981, pour atteindre N’Djamena, je prends le bac à Kousséri, la localité camerounaise qui fait face à la capitale tchadienne sur l’autre rive du Chari. Des pirogues et barges assurent l’essentiel d’un trafic constitué par le retour des Tchadiens qui avaient fui les combats. Surprenante au milieu de la cohue, une 504 battant pavillon tricolore stationne sur ce bac. C’est celle du chef de l’« antenne diplomatique » française, toujours établie sur la rive camerounaise, qui fait le va-et-vient pour renouer le dialogue avec les autorités tchadiennes et inspecter l’ambassade laissée à l’abandon après avoir été touchée par les combats de rue. N’Djamena est un champ de ruines. Abîmée mais encore debout, la mosquée s’en tire mieux que la cathédrale réduite à des pans de mur. Dans une « présidence de la République » quelque peu fantomatique, je recueille les nouvelles dispositions d’esprit de Goukouni Oueddei, ainsi résumées par un titre du Monde : « N’Djamena souhaite une aide accrue de la France et exige une “stricte neutralité” de Tripoli ».
Aux bons soins de « Rita »
Quelques mois après, Goukouni Oueddei est renversé par un revenant : Hissène Habré, qui supportait encore plus mal que lui la levée du drapeau de la Jamahiriya libyenne sur la « bande d’Aozou », ce territoire frontalier depuis longtemps revendiqué par Tripoli. Hissène Habré, l’ancien rebelle, le ravisseur de Françoise Claustre en 1974, s’est rapproché des Français et a obtenu d’eux le déclenchement de l’opération Manta quand d’autres rebelles soutenus par la Libye furent sur le point de s’emparer de Faya-Largeau et de marcher sur la capitale. Après avoir permis de contenir cette offensive, Manta a été remplacée par le dispositif aéroterrestre Épervier. L’intervention française a alors changé de nature. Il ne s’agit plus seulement de veiller de façon strictement défensive au maintien du statu quo, mais d’aider l’armée tchadienne à reconquérir les territoires perdus au Nord.
Le 4 avril 1987, je suis en face du colonel Joseph, un officier de l’Armée de l’air qui commande Épervier. Il m’explique l’importance stratégique de la base de Ouadi-Doum que les Libyens tenaient à 800 kilomètres de N’Djamena, dans le Nord. Entre deux collines rocheuses, c’était une concentration de matériels de guerre au bord d’une piste longue de 3 800 mètres, très bien protégée. C’est cette base, défendue par cinq mille Libyens, que les hommes d’Hissène Habré viennent de prendre au moyen d’un « raid-éclair, modèle du genre ». La nouvelle a fait sensation et plusieurs rédactions parisiennes sont représentées dans des hôtels plein de clients français au crâne rasé, manifestement des militaires en civil. Cependant, il ne faut pas que la France s’affiche trop dans cette histoire. Même si l’état-major souhaite aider Hissène Habré à pousser son avantage jusqu’à une victoire totale, la consigne est au « profil bas ». « Les hommes du dispositif Épervier n’ont pas tiré un coup de feu, même les trois gus du 11e Choc », me dit un adjoint du colonel Joseph. En évoquant ces « trois gus », cet officier fait allusion à la présence d’éléments révélée de source américaine mais officiellement démentie . Ces « trois gus », dont le rôle est mentionné comme par inadvertance, c’est un scoop dont me font cadeau des militaires probablement agacés par la pusillanimité gouvernementale. Seulement, comment le transmettre à Paris ? N’Djamena n’est toujours pas une ville normale. Le combiné de ma chambre d’hôtel est purement décoratif. « Écrivez votre papier, dit le colonel, et apportez-le nous. Rita s’en chargera. » Rita n’est pas un « personnel féminin ». Il faut comprendre « Réseau intégré de transmissions automatiques », une espèce de fax sécurisé. Quelques heures après, à Paris, le ministère de la Défense se fait un plaisir de dépêcher au journal un motard porteur de ma copie (1).
« En Centrafrique, nous pouvons nous exprimer pleinement »
C’est de la base aérienne de N’Djaména que partirent en septembre 1979 les éléments français chargés d’installer David Dacko à Bangui, profitant d’un voyage de Bokassa en Libye. Toujours inspirée par la faune terrestre ou aquatique des pays chauds, l’armée a donné à cette opération le nom de « Barracuda ». Invoquant sa qualité d’ancien gradé de l’armée française, Bokassa, au retour de Tripoli, a tenté de faire poser sa Caravelle sur la base militaire d’Évreux. Cela lui a été refusé, mais on lui a trouvé un asile en Côte d’Ivoire. En décembre 1980, les nouvelles autorités centrafricaines ont néanmoins tenu à organiser un procès par contumace, auquel j’assiste, dans une ville apaisée par la présence de Barracuda.
« Bokassa, Jean-Bedel, en fuite, marié, père de trente-trois enfants ». Le président du tribunal se taille un succès facile en évoquant la nombreuse progéniture du personnage, dont un fils est prénommé Saint-Cyr. « Les Barracudas », comme les appellent les Banguissois qui ont adopté le nom de code de l’opération française, sont partout en ville, simples soldats véhiculés par camion ou gradés en uniforme assis à l’arrière de Peugeot « civiles ». Le « cantonnement » est situé dans les anciennes villas construites pour les invités au « sacre » de « l’empereur ». « Nous ne sommes pas véritablement installés, nous ne savons pas quand prendra fin notre mission », me précise le colonel Yves Béchu, dont le titre officiel est « commandant des éléments français stationnés en Centrafrique ». Venus de différentes unités, « les Barracudas » font un séjour de dix semaines en Centrafrique, ravitaillés par des DC-8 en provenance de « métropole », comme cela se dit par inadvertance. Une partie du contingent français, quelques centaines d’hommes, est positionnée à Bouar, un « camp d’entraînement » situé à 300 km au nord-ouest de Bangui, près du Cameroun. La piste de Bouar ne se prêtant pas à l’atterrissage de gros-porteurs, c’est à Bangui que se posent les appareils des « opérations mil », la distribution de vivres aux populations frappées par les pénuries alimentaires, notamment à Birao, au nord du pays, non loin de la frontière soudanaise. Des soldats sont « lâchés dans la nature » pour reconnaître l’état des pistes laissées à l’abandon sous Bokassa, dit le colonel Béchu. Il ajoute : « Ce travail correspond à la mission de l’armée, qui n’est pas seulement de défense. Ici, nous sommes des hommes heureux parce que nous pouvons nous exprimer totalement. »
Le 24 septembre, au moment où l’on attend le verdict du procès, l’armée met au point une opération consistant à faire sauter, sur un stade de Bangui, un parachutiste habillé en Père Noël, avec des cadeaux pour les enfants. « Barracuda Père Noël » efface en partie la mascarade du sacre « napoléonien » avec la participation de la musique des Troupes de Marine sur ordre ministériel.
1986 : « Montrer les cocardes tricolores » à Lomé
Mercredi 24 septembre 1986, à Lomé, capitale du Togo : un commando venu du Ghana tente de s’emparer de la « caserne présidentielle », le camp de Tokoin, où le général Eyadema, passe habituellement ses nuits. Ce commando a été repoussé, mais, parmi les civils tués, il y a un des quatre mille Français recensés au Togo. Eyadema téléphone à François Mitterrand pour lui demander de l’aide en vertu d’un accord de défense. Après consultation du Premier ministre Chirac, en cette période de « cohabitation », le chef de l’État donne son feu vert.
J’arrive à Lomé à temps pour relater dans mon journal la mise en place d’un dispositif auquel on n’a même pas eu le temps de trouver un nom de code : « Jeudi, cent trente hommes du 3e Régiment de parachutistes d’infanterie de marine basés au Gabon, une cinquantaine de militaires de l’état-major du groupement aéroporté d’Albi prépositionné à Bangui, sont mis en état d’alerte. Le lieutenant-colonel Charrier, commandant de l’opération, décolle de la capitale centrafricaine à 17 heures. Le premier des quatre avions Transall se pose, tous feux éteints, à 20 h 30, alors qu’il fait déjà nuit à Lomé. » Quatre Jaguar sont associés à l’opération, depuis la base aérienne de Niamtougou, à 400 km au nord de Lomé, près du village natal d’Eyadema. Fonctionnant depuis longtemps avec une assistance technique française, cette base est équipée de réserves d’oxygène indispensables aux pilotes de ces avions d’attaque lointaine. Le vendredi matin, les quatre Jaguar font un « vol de dissuasion » à basse altitude au-dessus de Lomé. « Il faut montrer les cocardes tricolores », me dit le lieutenant-colonel Charrier.
Les « bérets rouges » sont cantonnés près de l’aéroport. L’effet de dissuasion se produisant, la ville est calme. À l’entrée du camp de Tokoin, le dimanche 28, les chœurs de civils, hommes et femmes, chantent inlassablement des refrains à la gloire d’Eyadema et de Mobutu qui s’est invité à Lomé sous prétexte qu’il a également envoyé un détachement militaire, détachement dont le comportement indiscipliné suscite une comparaison avantageuse pour l’uniforme français. Les « groupes d’animation » du parti unique ont été mobilisés pour l’accueil du Zaïrois venu inspecter l’armement du commando ennemi d’un air connaisseur. Bien rangés sur des tables, il y a quelques dizaines de fusils d’assaut kalachnikov, des grenades quadrillées, des poignards, des pains d’explosifs. « On avait des renseignements, on les attendait », me confie le général français Maurice Mathiote, qui résidait à Lomé avec le titre de « conseiller technique du chef d’état-major général des forces armées togolaises », autrement dit un très proche du Président. De ses demi-confidences, il ressort que les préparatifs d’un coup monté au Ghana étaient éventés, énième épisode d’une longue vendetta menée depuis Accra par la famille de Sylvanus Olympio, le président togolais abattu en 1963 par Eyadema, ancien sous-officier de l’armée française, mécontent de sa solde dans l’armée du Togo indépendant.
En janvier 1987, les délégations d’une cinquantaine de pays sont invitées à Lomé pour « le 20e anniversaire de la libération nationale », c’est-à-dire la prise du pouvoir par Eyadema, quatre ans après la mort d’Olympio. Le lieutenant-colonel Charrier figure parmi les invités, en remerciement de son action à la tête du détachement français intervenu en septembre. Un dîner de gala a lieu pour clôturer les festivités. De là où je suis placé, je ne peux pas voir s’il fredonne en même temps qu’Eyadema les airs que celui-ci aime à faire jouer par un orchestre, parce qu’ils « lui rappellent sa jeunesse » : « Auprès de ma blonde », « En passant par la Lorraine »…
Apaiser les grandes peurs des Blancs
Apparemment, personne n’avait songé que la presse française pouvait débarquer en force à Libreville vendredi matin 25 mai 1990, après que l’Élysée eut annoncé l’envoi d’unités parachutistes, « avec l’accord » (mais non à la demande) du président Bongo, en raison d’émeutes et de pillages dans la capitale gabonaise et à Port-Gentil, la ville du pétrole. Pas de représentant de l’ambassade, pas de consignes officielles, à l’arrivée du vol Air Gabon parti de Paris à minuit. À l’aéroport Léon M’Ba, c’est cependant un commandant français, qui collecte les passeports dans l’attente des instructions. Au bout d’une heure, après que cet officier eut « réveillé le général gabonais responsable », la réponse arrive : pas d’entrée au Gabon, départ immédiat pour Luanda, le prochain vol annoncé. Protestations des journalistes, l’officier français prend sur lui de donner l’autorisation de porter les valises dans un hôtel proche de l’aéroport.
Quelques voyageurs, résidents étrangers au Gabon, ont observé la scène avec perplexité. Ceux-là veulent prendre l’avion. La mort suspecte d’un opposant a suscité une flambée de violence. Forte de 20 000 inscrits au consulat, la communauté française du Gabon est la deuxième d’Afrique noire. Les nouvelles du quotidien national L’Union ne sont pas faites pour la rassurer : à Port-Gentil, « un Européen a été bastonné à sang » et cinq autres « torse nu, ont été obligés de défiler avec les manifestants en tenant des pancartes et en scandant des mots hostiles au régime ». Une fois encore, c’est la grande peur des Européens pris dans un accès de furie africaine, celle qui a amené la Légion à se substituer aux Belges pour sauter sur Kolwezi, en mai 1978.
L’ambassade de France est en émoi. Sortis du camp de Gaulle, près de l’aéroport, où ils sont habituellement cantonnés, des hommes du 6e Bataillon d’infanterie de Marine tapent la carte à l’intérieur, avec, à leurs pieds, le fusil d’assaut et le casque lourd. En effet, l’ambassadeur n’est plus sûr de rien malgré le calme apparent de la capitale. Deux unités de la Légion étrangère sont venues en renfort depuis la France pour prendre le contrôle de Port-Gentil. Les Transall français ont déjà ramené plusieurs centaines d’étrangers de Port-Gentil à Libreville.
En attendant un « vol spécial » pour Port-Gentil que l’armée française a promis aux journalistes, je m’engage avec un confrère de Radio France internationale sur la longue route de latérite menant à Lambaréné, un nom qui doit dire quelque chose à nos auditeurs et lecteurs du fait de l’hôpital fondé là-bas par le médecin-musicien Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix 1952. Presque tous les magasins ont été attaqués. Les stations-service ont flambé. Sur la quarantaine de Français qui vivent à Lambaréné, une quinzaine sont réfugiés dans la mission des Sœurs de l’Immaculée conception ; les autres « dorment sur les balcons avec un fusil ». Un « broussard » raconte : « Un hélicoptère de l’armée française s’est posé ici, hier. Deux capitaines, des bérets verts, venaient s’informer. Ils ont promis qu’un avion venu de Centrafrique nous prendrait si nécessaire. » Lambaréné est doté d’un petit aéroport. Mon confrère et moi, nous quittons des compatriotes dans l’attente du bruit salvateur d’un vol militaire français. Revenus trop tard à Libreville pour profiter du « vol spécial » organisé par l’armée, nous gagnons Port-Gentil à bord d’une vedette conduite par un Européen organiseur de croisières « en temps de paix ».
Une fois passées les plates-formes pétrolières dont toutes les torchères sont éteintes, nous sautons dans l’eau devant une plage. Nous arrivons, trempés, à un barrage tenu par un officier qui tient à s’identifier : « Lieutenant X, du 2e Régiment étranger d’infanterie de Nîmes ». Un camion vient nous chercher pour nous conduire au Ranch, un hôtel où sont installés un hôpital de campagne et un PC. Quand il m’accorde un moment, le général Bernard Janvier, chef de l’opération Requin, prend congé du consul Bernard Petit, en poste à Douala mais chargé d’une « mission d’action et d’évaluation » par le Quai d’Orsay. Conduit à l’aéroport dans un camion de soldats en armes, le consul s’excuse devant moi de ce déploiement pour sa seule personne. Ce diplomate risque d’être pris en otage, m’explique un officier, et « il faut toujours prendre ces menaces au sérieux, tellement leur mise à exécution est facile et tellement c’est lourd de conséquences ». Ce qui est palpable en cet instant, et que l’officier ressent avec fierté de son côté, c’est que beaucoup de choses dépendent de très peu d’hommes.
Omar Bongo, le président gabonais que l’opération Requin sortit d’une mauvaise passe, était une figure de la « Françafrique », au sens péjoratif que ce mot a pris au fil du temps (2). Aux yeux du reporter auquel elle s’ouvrait loyalement, sur le terrain, dans le strict accomplissement des missions militaires qui lui étaient données, l’armée française n’était pas au service de cette « Françafrique »-là. ♦
(1) « Magnifique guerrier » selon les officiers français qui l’ont vu à la manœuvre, mais dictateur sanguinaire, Hissène Habré fut lâché par Paris et renversé en 1990. Condamné à la prison à vie pour « crimes contre l’humanité » par un tribunal africain, il est mort de la Covid en détention à Dakar en 2021.
(2) Le mot « Françafrique » avait été employé par le président ivoirien Houphouët-Boigny pour exalter l’étroitesse des liens entre la France et l’Afrique. Plus tard, le pamphlétaire François-Xavier Verschave, suivi par divers auteurs, lui donna un tout autre sens dans La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1988.

 (T 1435).jpg)