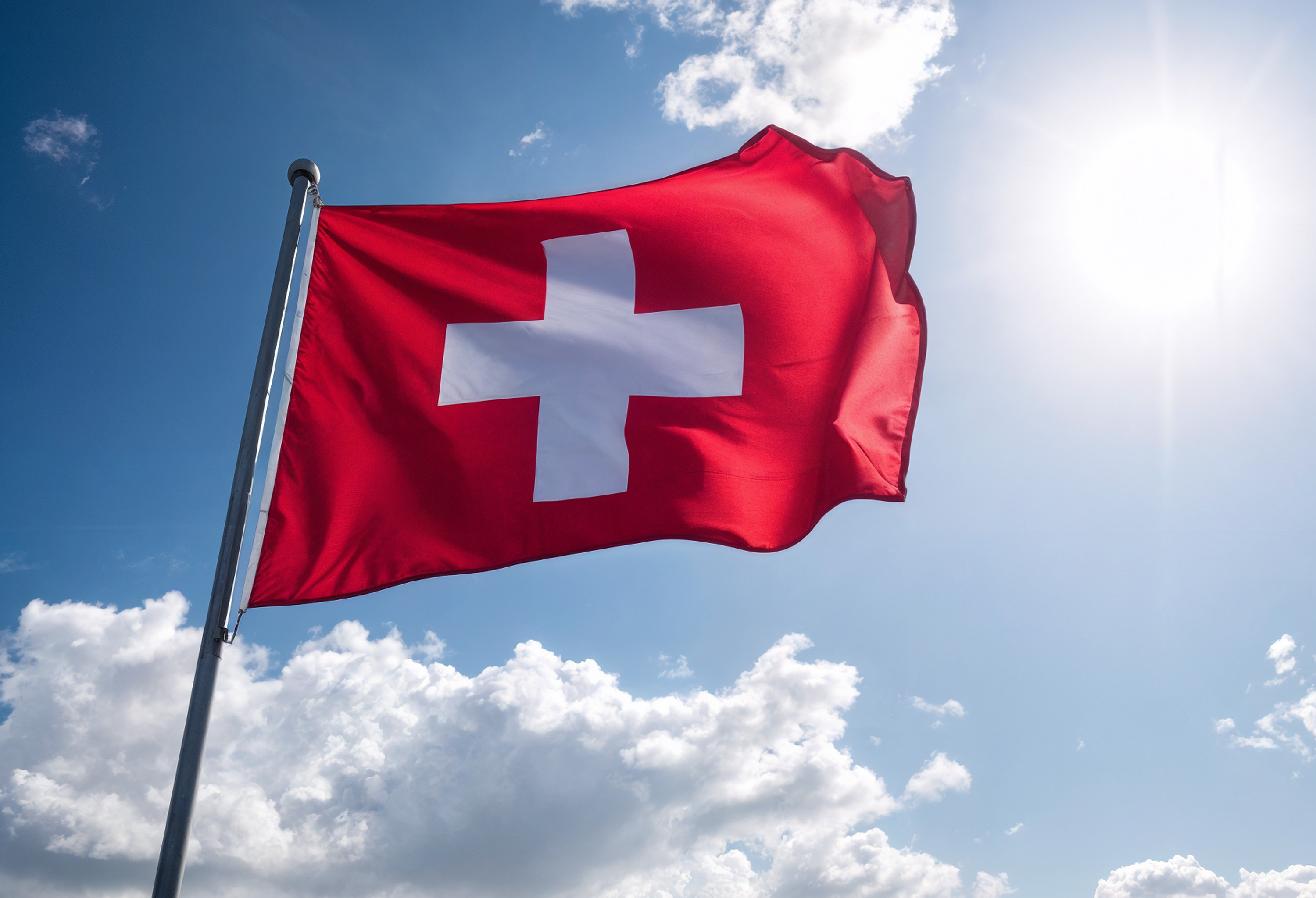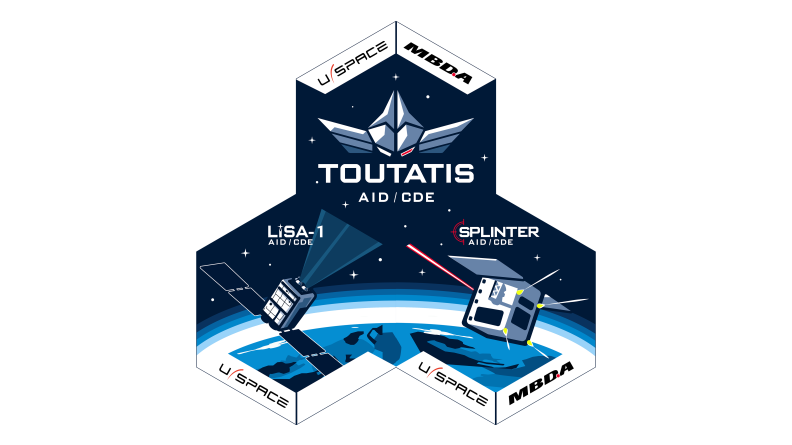Parfait connaisseur du Royaume saoudien (« L'Arabie Saoudite, aujourd'hui et demain », nov. et déc. 1978 ; « L'Arabie Saoudite, quel avenir économique ? », AS 1979), l'auteur élargit cette fois son sujet à l'ensemble de l'Islam et nous fait sortir du cadre doré mais étroit de l'Islam arabe pétrolier auquel sont consacrées la plupart des études. Comment interpréter les événements qui troublent actuellement le monde musulman ? S'agit-il vraiment d'un réveil, comme on le dit souvent dans la presse ? Celui-ci, en réalité, a commencé depuis la confrontation des pays islamiques, au cours du XIXe siècle, avec des idéologies qui lui étaient étrangères, laïques, venues d'Occident avec la colonisation, notamment le nationalisme et le socialisme que l'Islam a adoptés. Mais la culture, les modes de vie, les mœurs occidentales, par certains de leurs aspects les plus négatifs, troublent les consciences.
Un réveil qui a conduit dans les dernières décennies à la décolonisation politique, à une tentative manquée de récupérer une certaine indépendance économique et, enfin, à une revendication d'identité culturelle nationale sous le signe de l'Islam ; une protestation contre la colonisation intellectuelle de l'Occident ; on assiste à une phase particulièrement active de ce réveil. L'Islam joue un rôle essentiel aujourd'hui dans la vie politique des pays musulmans, à l'intérieur comme sur le plan international. L'analyse des grands courants de la pensée musulmane contemporaine qu'effectue l'auteur révèle une position commune d'hostilité face au marxisme athée.
Où mène tout ce tumulte, se demande-t-il ? Dans un monde multipolaire, l'Islam a sa place ; son avenir n'est pas dans le retour au passé mais dans un renouveau qui lui ferait épouser le monde moderne en gardant sa haute spiritualité. Une novation nécessaire que seule la communauté musulmane peut entreprendre. Ce qui reste encore à faire. La seconde partie de cette importante étude qui éclaire les problèmes de l'Islam contemporain paraîtra dans le numéro de décembre.
L’Islam, on en parle beaucoup depuis quelque temps. Par les positions stratégiques qu’il occupe, les clefs économiques que détiennent des pays musulmans (les 2/3 des réserves mondiales de pétrole), par sa force d’expansion sur deux continents, l’Islam est une réalité vivante mais complexe : 800 millions d’individus, le quart de notre planète, le quart aussi des États membres de l’ONU, la moitié du Tiers Monde représenté aux Conférences pour le commerce et le développement (CNUCED) par le « groupe des 77 » (devenus 119).
Un monde islamique formant de grosses masses : 123 millions d’Arabes ou arabisés, 130 millions dans le Sud-Est asiatique, dont 95 % en Malaisie et Indonésie. Entre les deux groupes : les 220 millions de musulmans du sous-continent indien (Pakistan, Bangladesh, Inde) et les 60 millions d’Iraniens et d’Afghans. En Afrique noire, environ 70 millions de musulmans : chiffre en augmentation, car l’Islam y est en expansion, notamment au Cameroun. Dans la suite de l’article, nous entendons par « monde musulman » l’ensemble cohérent de pays ou de régions où les musulmans forment une partie importante de la population. À l’intérieur de cette entité, nous appellerons « États musulmans » des États indépendants à majorité musulmane, que l’Islam y soit religion d’État ou non. Officiellement, 42 pays étaient représentés à la dernière conférence islamique tenue à Fès en mai 1979. Mais de fortes communautés sont intégrées à des pays non musulmans (URSS – Inde – Chine – Thaïlande – Philippines – Nigeria). Certains délèguent des observateurs aux diverses manifestations du nouveau mouvement panislamique.
Tout ce monde est en turbulence. Par sa seule force, l’Islam a contraint à l’exil le chah d’Iran et abattu un régime qui ne manquait pas de moyens de pression et d’oppression, bouleversant ainsi l’équilibre des forces au Proche-Orient. Ailleurs, au Pakistan, on veut restaurer la loi de l’Islam dans la législation. En Afghanistan, une rébellion musulmane lutte contre un gouvernement marxiste pro-soviétique au drapeau rouge orné d’une étoile d’or. En Turquie même, que penserait Mustapha Kemal de la vigueur de l’Islam après un demi-siècle de laïcisation de l’État ? Le nombre de pèlerins turcs à La Mecque grandit chaque année et l’on recrée à Ankara un ministère des Affaires religieuses. Un peu partout les mosquées se remplissent. À Damas, au Caire, à Tunis, de jeunes femmes, dont les mères sont dévoilées depuis longtemps, abandonnent leur blue-jean et reprennent volontairement le vêtement féminin traditionnel. Une vague de puritanisme submerge l’Islam. Au Caire, les photos de Brigitte Bardot sont jetées au feu… !
Islam, musulman, chiisme, sunnisme, umma