Chine, puissance africaine. Géopolitique des relations sino-africaines (China’s power in Africa. The geopolitics of Sino-African relations, reviewed by Carine Pina)
Chine, puissance africaine. Géopolitique des relations sino-africaines
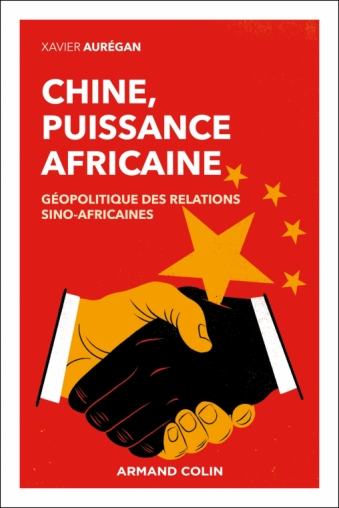 À l’heure des bouleversements internationaux et de la place du continent africain dans le possible nouvel agencement de l’ordre mondial, les relations sino-africaines, souvent surinterprétées, voire fantasmées, s’avèrent être une question stratégique majeure. Le livre écrit par Xavier Aurégan, enseignant-chercheur à l’Institut catholique de Lille et associé à l’Institut français de géopolitique (IFG-Lab) ainsi qu’au Conseil québécois d’études géopolitiques, offre un état des lieux bienvenu sur la question de la présence chinoise en Afrique. L’ouvrage se divise en trois parties chronologiques couvrant une période depuis 1949 à nos jours, permettant de rappeler trois faits majeurs de la présence chinoise sur le continent africain. En premier lieu, les relations sino-africaines ne sont pas nouvelles, elles remontent au début des années 1950. En deuxième lieu, elles sont allées crescendo en s’étoffant au rythme de la montée en puissance de la Chine. Enfin, l’augmentation des échanges sino-africains et leurs complexifications ne sont pas le fait de l’arrivée au pouvoir en Chine de Xi Jinping en 2013, mais bien de son prédécesseur, Hu Jintao, président de 2003 à 2013 – bien que le projet des Nouvelles routes de la soie ait ouvert de nouvelles perspectives et de nouveaux enjeux.
À l’heure des bouleversements internationaux et de la place du continent africain dans le possible nouvel agencement de l’ordre mondial, les relations sino-africaines, souvent surinterprétées, voire fantasmées, s’avèrent être une question stratégique majeure. Le livre écrit par Xavier Aurégan, enseignant-chercheur à l’Institut catholique de Lille et associé à l’Institut français de géopolitique (IFG-Lab) ainsi qu’au Conseil québécois d’études géopolitiques, offre un état des lieux bienvenu sur la question de la présence chinoise en Afrique. L’ouvrage se divise en trois parties chronologiques couvrant une période depuis 1949 à nos jours, permettant de rappeler trois faits majeurs de la présence chinoise sur le continent africain. En premier lieu, les relations sino-africaines ne sont pas nouvelles, elles remontent au début des années 1950. En deuxième lieu, elles sont allées crescendo en s’étoffant au rythme de la montée en puissance de la Chine. Enfin, l’augmentation des échanges sino-africains et leurs complexifications ne sont pas le fait de l’arrivée au pouvoir en Chine de Xi Jinping en 2013, mais bien de son prédécesseur, Hu Jintao, président de 2003 à 2013 – bien que le projet des Nouvelles routes de la soie ait ouvert de nouvelles perspectives et de nouveaux enjeux.
Outre cette présentation chronologique des relations sino-africaines, l’ouvrage s’attache à présenter les nombreux aspects de la présence chinoise sur le continent africain. Si cette dernière s’illustre avant tout dans le domaine économique (commercial, investissements), elle s’avère en réalité multiple : l’aide au développement, la santé, les migrations et la sécurité sont des thèmes abordés. Ces différents sujets permettent ainsi de souligner la diversité des acteurs chinois sur le continent qui ne sont plus uniquement des composantes de l’État chinois, mais bien des acteurs privés. Enfin, si Xavier Aurégan montre les limites et les problèmes générés par cette présence chinoise (dettes, corruption-clientélisme, prédation des ressources naturelles), il en souligne également les mérites (développement des infrastructures africaines, meilleure intégration du continent dans le commerce mondial). À ce propos, l’auteur insiste sur la nécessité de prendre en considération le point de vue africain à travers l’agentivité des États africains et le regard des populations du continent à l’égard des relations avec la Chine.
L’ouvrage se clôt sur un chapitre édifiant concernant les enjeux sécuritaires et politiques que posent le continent africain à la Chine au regard de ses nombreux intérêts présents sur place. En effet, la présence de plus en plus de ressortissants chinois installés dans des États conflictuels – ou en phase de le devenir – confronte la Chine, et plus particulièrement le Parti communiste chinois (PCC), à l’impérieuse nécessité d’assurer la sécurité de ses citoyens et de ses biens. Afin d’y répondre, la Chine déploie divers moyens sécuritaires allant de l’Armée populaire de libération (APL) pour des évacuations ponctuelles à l’établissement d’une base de ravitaillement installée à Djibouti, en
passant par des accords liés aux polices et au recours à des sociétés privées de sécurité. En effectuant de telles démarches, la Chine tente d’assurer sa présence via des moyens diplomatiques et politiques dont la finalité renforce son influence politique, organisationnelle et informationnelle.
Illustré par de nombreuses cartes et données statistiques, l’ouvrage de Xavier Aurégan s’avère être une lecture utile pour qui souhaite avoir une connaissance non essentialiste de la présence chinoise en Afrique.♦




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)



