War-Making as Worldmaking: Kenya, the United States and the War on Terror
War-Making as Worldmaking: Kenya, the United States and the War on Terror
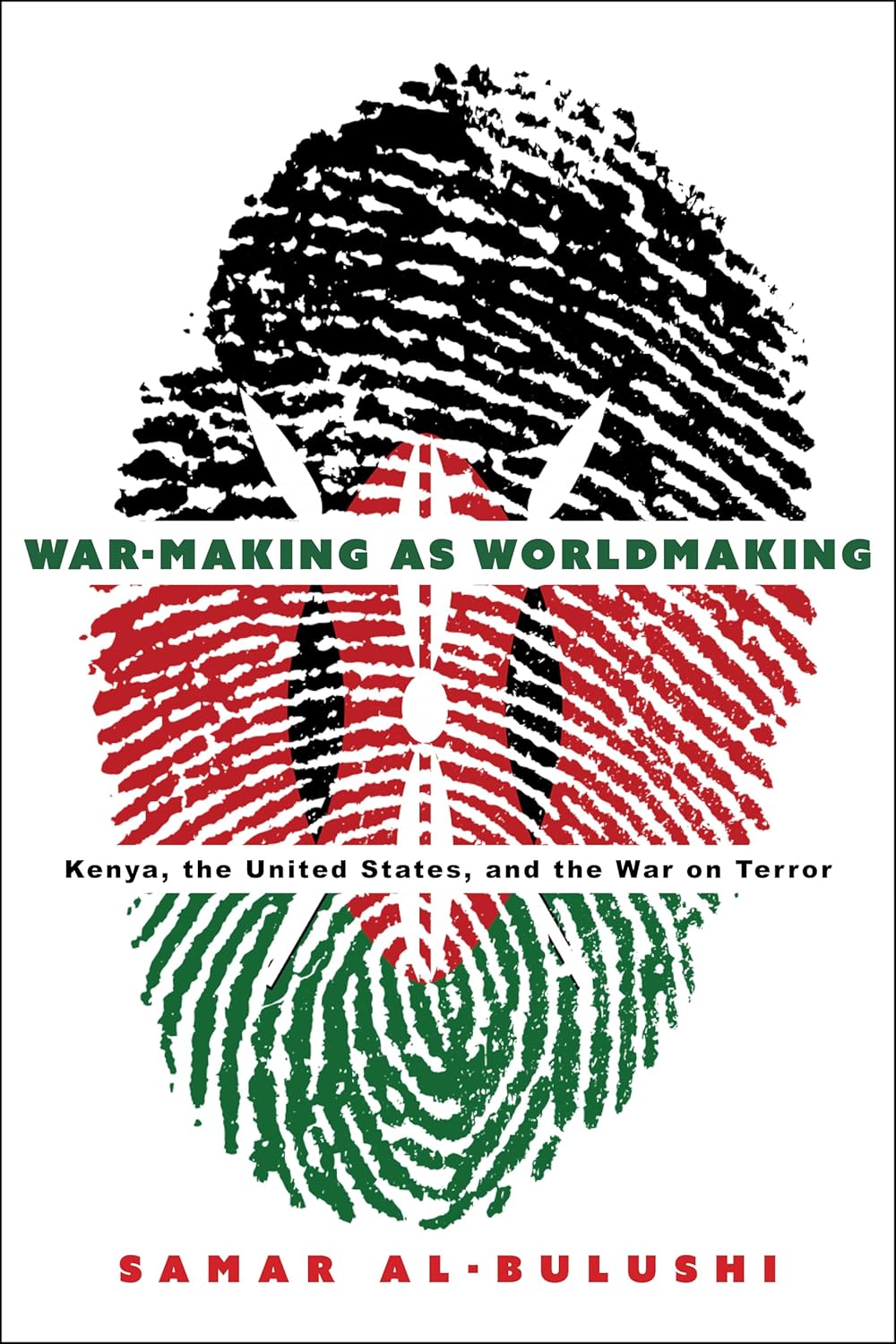 Dans son ouvrage, le professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Californie d’Irvine Samar Al-Bulushi nous livre une analyse constructiviste et originale des effets de la lutte contre le terrorisme sur les sociétés africaines, en prenant l’exemple du Kenya. Partant d’une démarche anthropologique, elle dépasse ce cadre pour interroger la manière dont les pratiques militaires, les logiques sécuritaires et les coopérations internationales façonnent le monde à travers la production d’un ordre politique, social et moral nouveau. La thèse d’Al-Bulushi est que la fabrique de la guerre (war-making) est indissociable de la fabrique du monde (worldmaking) qui redessine les relations entre l’État, la société civile et les individus. L’étude s’étend de la guerre des bandits (Shifta War) à nos jours, nous faisant comprendre comment la convergence entre la politique sécuritaire américaine internationale qui s’est servie d’un catalyseur régional et le développement de l’appareil sécuritaire national, a été un facteur constitutif de cet État.
Dans son ouvrage, le professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Californie d’Irvine Samar Al-Bulushi nous livre une analyse constructiviste et originale des effets de la lutte contre le terrorisme sur les sociétés africaines, en prenant l’exemple du Kenya. Partant d’une démarche anthropologique, elle dépasse ce cadre pour interroger la manière dont les pratiques militaires, les logiques sécuritaires et les coopérations internationales façonnent le monde à travers la production d’un ordre politique, social et moral nouveau. La thèse d’Al-Bulushi est que la fabrique de la guerre (war-making) est indissociable de la fabrique du monde (worldmaking) qui redessine les relations entre l’État, la société civile et les individus. L’étude s’étend de la guerre des bandits (Shifta War) à nos jours, nous faisant comprendre comment la convergence entre la politique sécuritaire américaine internationale qui s’est servie d’un catalyseur régional et le développement de l’appareil sécuritaire national, a été un facteur constitutif de cet État.
Depuis l’attentat de l’ambassade américaine à Nairobi par Al-Qaïda en 1998, qui déclenche l’une des plus vastes enquêtes du Federal Bureau of Investigation (FBI) hors des États-Unis, le Kenya s’intègre activement à l’architecture mondiale du contre-
terrorisme sous supervision américaine, devenant un partenaire stratégique dans la lutte contre le groupe terroriste djihadiste somalien, Al-Shabaab, depuis 2011. Ce partenariat s’est traduit par un afflux de financements militaires, de formations sécuritaires et d’une coopération directe avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le détachement spécial anti-terroriste conjoint de la Corne de l’Afrique et la Central Intelligence Agency (CIA). Au-delà de ces aspects concrets du partenariat, cette coopération a façonné en profondeur les institutions sécuritaires locales notamment en permettant l’instauration de l’Anti-Terrorism Police Unit, le National Counter Terrorism Center ou encore de la Kenyan Rapid Response Team.
L’ouvrage montre comment les forces kényanes, formées aux techniques de contre-insurrection, les internalisent et les utilisent sur des cibles différentes de celles identifiées par les États-Unis. Al-Bulushi décrit la supervision par la CIA de ces programmes d’entraînement à la traque, à l’interrogatoire et à la neutralisation de cibles dites
« terroristes » au mépris des règles de droit. Par ailleurs, le FBI a opéré aux côtés des autorités locales dans des opérations conjointes, souvent en dehors du droit kényan. Ce soutien s’est traduit sur le terrain par des disparitions forcées, des détentions extrajudiciaires et une surveillance intrusive des populations musulmanes, en particulier d’origine somalienne. L’auteur montre que le Kenya ne fait pas qu’importer des techniques de guerre : c’est un laboratoire d’un nouveau modèle de gouvernement, fondé sur la production du danger et la marginalisation de certains segments de la population. La violence d’État devient constitutive du lien politique.
Le récit d’Al-Bulushi est traversé de témoignages poignants d’activistes, d’avocats et de citoyens ordinaires proches des minorités stigmatisées qui révèlent les traumatismes, les résistances, mais aussi les dilemmes moraux que cette politique produit au quotidien. Certains paradoxes de la société civile kenyane sont ainsi mis en lumière : la nécessité de dénoncer les abus et les risques que cela fait peser sur les militants des droits humains, souvent criminalisés ou intimidés, mais aussi, ces mécanismes d’aide au
développement et de diplomatie internationale qui, sous couvert de « renforcement des capacités » et de « bonne gouvernance », légitiment en réalité un durcissement autoritaire. Al-Bulushi analyse en particulier la manière dont certaines Organisations non-gouvernementales (ONG) ou bailleurs de fonds internationaux via l’assistance contre l’extrémisme violent (Countering Violent Extremism) cautionnent l’extension de l’appareil sécuritaire, tant que celui-ci s’inscrit dans une logique d’efficacité antiterroriste. Cette complicité implicite entre humanitaire et militaire renforcerait la capacité des États à s’imposer en garants de la stabilité, tout en étouffant les contre-pouvoirs. Le Kenya, présenté comme modèle de démocratie libérale en Afrique, a fait sien des méthodes et un ordre externe. Ce processus de worldmaking est donc celui d’une hégémonie diffuse, dans laquelle les priorités du contre-terrorisme recomposent les normes du politique.
Cette étude résonne avec les évolutions géopolitiques contemporaines. Alors que les États-Unis se désengagent d’un continent qu’ils n’ont que sporadiquement investi, la réalité est celle d’une délégation croissante des fonctions répressives à des partenaires locaux. Ce retrait apparent masque une continuité stratégique, la guerre contre le terrorisme n’est plus seulement menée par les États-Unis mais par des régimes locaux investis d’un mandat sécuritaire. Dans un contexte africain marqué par l’expansion des groupes armés non étatiques, la militarisation croissante des politiques publiques et le recul des droits civiques, cette lecture revisite notre compréhension de la souveraineté et de la coopération internationale. Au final, War-Making as Worldmaking est une démonstration de la manière dont l’Afrique devient le terrain expérimental d’un nouvel art de gouverner, fondé sur le narratif de la guerre. ♦




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)



