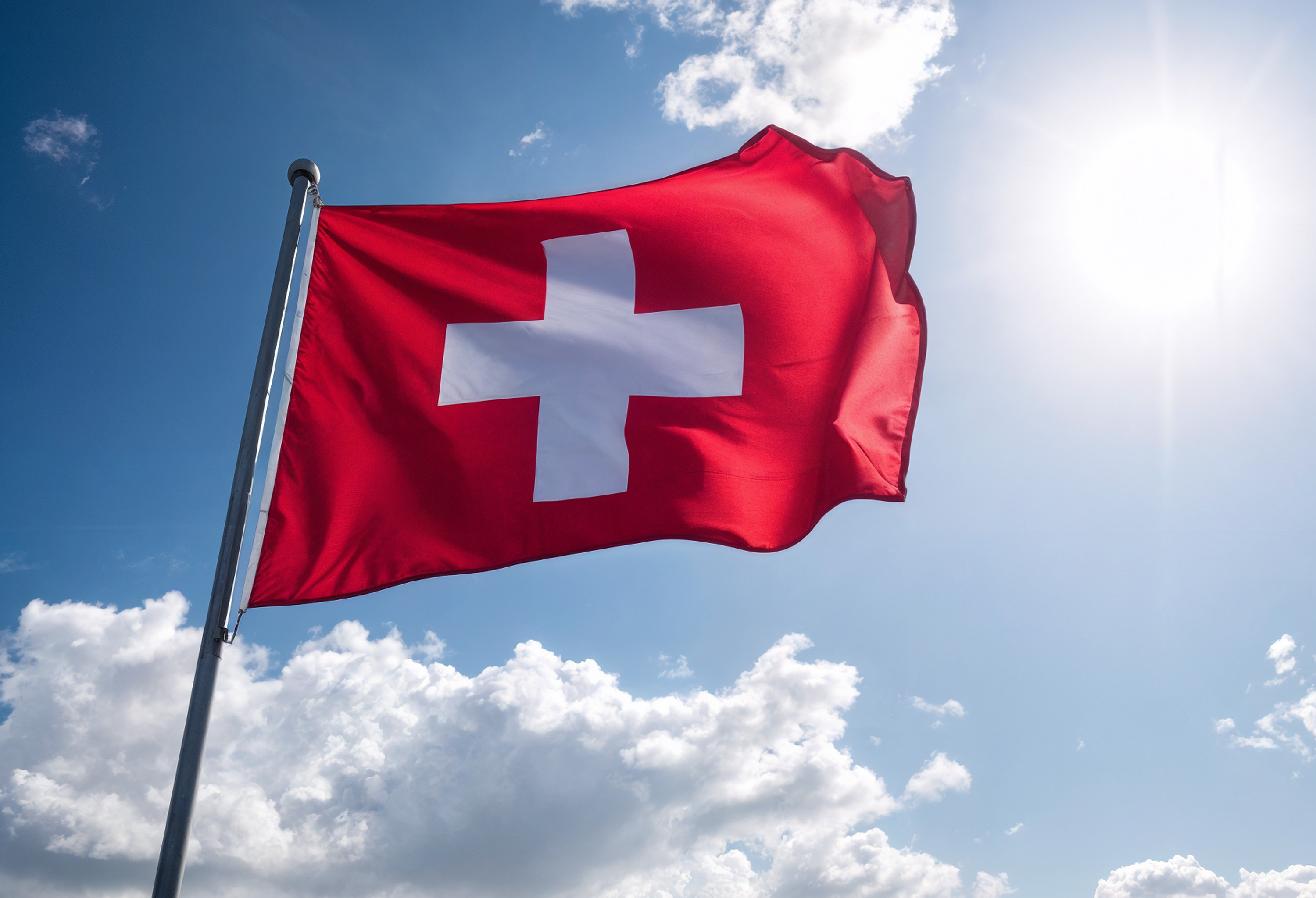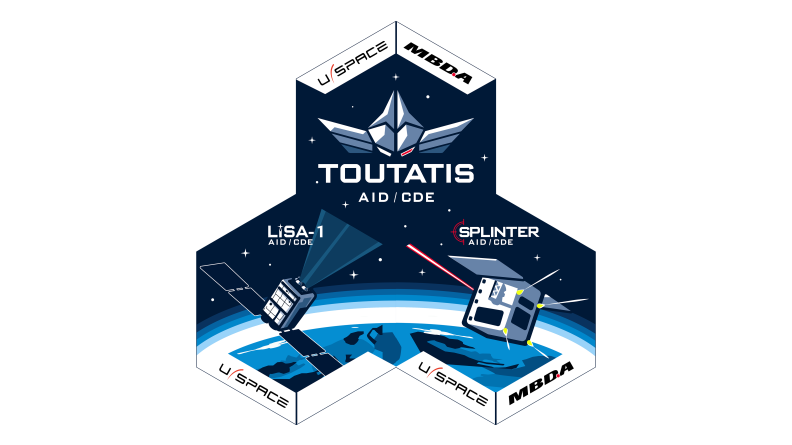Bien qu’historiquement opposés, la Russie et l’Arabie saoudite ont récemment amélioré leurs relations. Plutôt alliés respectivement de l’Iran et des États-Unis, faut-il voir dans ce rapprochement une réelle volonté de nouer des relations ou un subtil jeu diplomatique détourné.
Vers un axe russo-saoudien au Moyen-Orient ? (T 965)
Towards a Russian-Saudi axis in the Middle East?
Although historically opposed, Russia and Saudi Arabia have recently improved their relations. Rather allied respectively to Iran and the United States, we should see a real desire to build relationships or a subtle diplomatic game in this rapprochement hijacked.
Depuis quelques années nous assistons à une réimplication russe au Moyen-Orient. La Syrie fut le théâtre premier du retour de Moscou dans la région, d’abord via un soutien diplomatique sans faille à Bachar el-Assad, en se posant ensuite comme médiateur à l’été 2013 pour éviter un bombardement d’installations syriennes suite aux accusations d’usage d’armes chimiques par le régime. Puis, à partir de l’automne 2015, s’est ajoutée une intervention militaire, officiellement orientée contre les groupes terroristes, permettant au régime affaibli de se maintenir au pouvoir.
Conséquence directe de ce « retour » de Moscou dans le jeu moyen-oriental, nous assistons depuis peu à un rapprochement entre cette puissance réémergente et la puissance dominante arabe du Golfe, l’Arabie saoudite. Notre objectif est d’examiner les déterminants de ce rapprochement, ses possibles évolutions à venir et les limites auxquelles il sera confronté.
Une alliance contre-nature de prime abord
Des oppositions historiques
Ce rapprochement entre Russes et Saoudiens peut, au premier abord, apparaître comme contre-nature. Les deux pays ont eu, dans leur histoire récente, des relations particulièrement tendues. Dès la fondation du royaume en 1932, l’Arabie saoudite s’est alliée aux États-Unis, comme en témoigna ensuite la symbolique rencontre entre Abdelaziz Ibn Saoud et Franklin D. Roosevelt sur l’USS Quincy le 14 février 1945, point de départ d’une collaboration forte et qui a fait entrer l’Arabie dans le camp occidental, au tout début de la guerre froide.
Par la suite, l’URSS a soutenu les mouvements républicains arabes, notamment avec Gamal Abdel Nasser, hostiles aux monarchies arabes du Golfe, ayant pour conséquence des conflits ouverts comme au Yémen dans les années 1960, opposant les républicains soutenus par l’Égypte aux monarchistes soutenus par Riyad. L’Arabie saoudite s’est également caractérisée par son soutien aux moudjahidines afghans dans les années 1980 contre les forces soviétiques, avec les conséquences connues : Riyad est perçue comme la maison mère du wahhabisme et est, de fait, considérée comme responsable de la propagation de cet islam jugé radical dans certaines provinces russes (Daguestan, Tchétchénie, etc.) et en Asie centrale. Ainsi, rien ne permettait d’envisager un rapprochement qui aurait paru improbable il y a encore quelques années.
Une évolution du contexte
Plusieurs raisons expliquent ce rapprochement. La première est ce que l’on a souvent qualifié de « retrait américain » du Moyen-Orient sous l’ère d’Obama, en raison de la doctrine dite du « pivot asiatique » consistant à effectuer un désengagement de cette région pour se tourner davantage vers l’Asie (voir le rapport sous la direction de Mark E. Manyin). À ce pivot resté théorique, car suivi d’aucun désengagement américain concret du Moyen-Orient, il faut ajouter des divergences majeures entre l’Administration Obama et les États arabes du Golfe : refus de bombarder la Syrie à l’été 2013, appel à coexister avec l’Iran, signature de l’Accord sur le nucléaire iranien… Ces éléments eurent pour conséquence que les monarchies du Golfe se sentirent lâchées par leur allié américain.
La deuxième raison se trouve du côté de la Syrie. Avec son intervention, la Russie s’est positionnée comme un acteur clé au Moyen-Orient, qui va désormais compter dans les affaires de la région, et il est donc de l’intérêt de tous, y compris des Saoudiens, de s’en faire un allié, surtout dans une perspective de lâchage, à terme, de Bachar el-Assad.
La troisième raison est l’importance de la relation Iran-Russie. Moscou a souvent soutenu Téhéran sur la scène internationale, négociant et parvenant à atténuer les sanctions contre la République islamique au Conseil de sécurité. De fait, il est fort probable qu’en cherchant à se rapprocher de la Russie, les pays du Golfe – et l’Arabie saoudite en tête – cherchent à convaincre la Russie de lâcher l’Iran en lui faisant miroiter des perspectives de contrats.
Enfin une quatrième raison, moins spécifique à l’Arabie saoudite, est liée aux restrictions américaines sur les ventes d’armes aux pays du Golfe, en vertu du Qualitative Military Edge, qui impose de vérifier que toute vente d’armes au Moyen-Orient ne remette pas en cause la supériorité militaire d’Israël dans la région. Ces restrictions expliquent le refus américain de commercialiser son avion de combat F-35 aux monarchies arabes du Golfe, poussant les Émirats arabes unis à envisager avec la Russie la création d’un jet de 5e génération (cf. Sean Cronin). La Russie, comme la Chine et d’autres pays, sert ainsi de « plan B » pour les pays du Golfe qui n’ont pas réussi à obtenir ce qu’ils voulaient des États-Unis.
Une visite inédite
Ces évolutions contextuelles ont eu pour conséquence, en octobre 2017, la visite qualifiée « d’historique » du roi Salmane (sur le trône depuis janvier 2015) en Russie, une première pour un monarque saoudien, avec pour but officiel de « renforcer la coopération dans l’optique de diversifier les partenariats du Royaume » (cf. Saudi Press Agency), traduisant une volonté réciproque de partir sur de nouvelles bases. D’autant que, du point de vue russe, l’Arabie saoudite, en pleine mutation, offre un certain nombre d’opportunités : annonce du plan Vision 2030 visant à réduire la dépendance aux hydrocarbures, ouverture au tourisme, développement d’une industrie locale, développement de la filière nucléaire… Dans le même temps, nous assistons, à l’instigation du nouveau prince héritier Mohamed Ben Salmane, à une réduction des prérogatives de la police religieuse, à la réouverture des salles de cinéma, au droit de conduire accordé aux femmes. Ainsi, du point de vue de Moscou, l’ouverture saoudienne offre des perspectives variées pour les entreprises russes.
Perspectives de ce rapprochement
Un rapprochement au détriment des États-Unis ?
Tendue durant le second mandat Obama, la relation entre les États-Unis et l’Arabie saoudite a connu une nette évolution avec l’arrivée de Donald Trump. Après avoir pourtant tenu des propos plutôt durs durant sa campagne à l’encontre des pays du Golfe, le nouveau président américain a mené une politique radicalement opposée de celle de son prédécesseur : mise au ban de l’Iran, soutien inconditionnel à Israël, reprise des ventes d’armes aux pays du Golfe, notamment des bombes à guidage laser pour l’Arabie saoudite qu’Obama avait bloquées de crainte qu’elles ne soient utilisées au Yémen. L’apothéose fut atteinte en mai 2017 lorsque Donald Trump s’est rendu en Arabie saoudite pour son premier voyage à l’étranger, un signe fort, où il a assisté à un sommet États-Unis–monde musulman et d’où il est reparti la valise pleine de contrats et projets de contrats pour des montants dépassant les 300 milliards de dollars (cf. Zainab Fattah).
La crise du Golfe, qui a commencé en juin 2017, a également confirmé la convergence américano-saoudienne sur les dossiers régionaux : Donald Trump, contre l’avis du département d’État, a de facto soutenu l’initiative saoudienne et émiratie de boycott du Qatar, accusant publiquement sur son compte Twitter, le petit Émirat d’être responsable du terrorisme. Même si cela a donné lieu à une forte divergence au sein de l’administration américaine, le soutien de Trump traduit l’excellente convergence américano-saoudienne.
La question israélo-palestinienne et la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël le 6 décembre 2017 ne semble pas avoir provoqué de dégradation des relations entre les deux alliés. Des rumeurs, aussitôt démenties, circulent affirmant même que l’Arabie saoudite était prévenue de longue date de cette volonté de Donald Trump, et aurait demandé à Mahmoud Abbas en novembre dernier d’abandonner l’idée de Jérusalem comme capitale du futur État palestinien au profit d’une autre localité (cf. Alexander Fulbright).
Une pomme de discorde reste néanmoins l’adoption en 2016 du JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) par le Congrès américain, qui permet à tout citoyen américain de poursuivre aux États-Unis un État soupçonné de soutenir le terrorisme. Les pays du Golfe et l’Arabie saoudite en tête sont dans le collimateur, 15 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 étaient de nationalité saoudienne. Cela pourrait fortement dégrader les relations américano-saoudiennes dans les années à venir si des procédures étaient engagées.
De fait, compte tenu de la force de la relation entre les États-Unis et leur allié saoudien, les chances que l’Administration Trump laisse le champ libre à Moscou sont faibles. Et la réaction américaine ne s’est pas fait attendre. Au lendemain de la visite du roi Salmane en Russie, les États-Unis annonçaient qu’ils validaient la vente de systèmes de défense pour 15 milliards de dollars à l’Arabie saoudite, probablement suite à l’intérêt marqué des Saoudiens pour le système de défense russe S-400 (cf. Reuters). De même, l’Arabie souhaitant développer l’énergie nucléaire, les États-Unis sont sur les rangs et n’envisagent pas de laisser ROSATOM, le géant russe du nucléaire, leur voler la vedette (cf. Jennifer Jacobs et alii).
Réaction iranienne
Bien que l’Iran n’ait officiellement pas réagi à cette visite, Téhéran ne voit probablement pas d’un bon œil cette esquisse de rapprochement du rival saoudien avec son allié russe. Téhéran a en effet compris que l’un des objectifs de Riyad était de rallier Vladimir Poutine à sa cause, en témoigne la charge adressée par le roi Salmane contre l’Iran lors de son voyage à Moscou (cf. Isabelle Mandraud). Pour la République islamique, Russie et Chine sont des alliés indispensables, même si la relation avec Moscou a souvent été en dents de scie. Toutefois, il demeure peu probable que Moscou choisisse subitement de s’immiscer dans cette guerre froide régionale. Le récent soutien de Moscou à l’Iran au Conseil de sécurité des Nations unies suite aux manifestations populaires témoigne de l’absence d’infléchissement du soutien russe à Téhéran (cf. Conseil de sécurité).
Une relation à construire mais des embûches réelles
Dans une région où le relationnel et l’ancienneté des relations priment, les Russes accusent un retard certain par rapport à leurs homologues occidentaux, notamment américains, qui sont en place depuis des décennies. La route est ainsi longue pour Moscou avant de pouvoir prétendre remplacer les États-Unis aux yeux des Saoudiens. Et, d’ailleurs, le souhaitent-ils ? N’oublions pas également que la Russie est, pour l’heure, vue comme une puissance secondaire, et que les pays du Golfe préfèrent voir leur sécurité garantie par le numéro un que par le numéro deux, trois ou quatre…
Il y a aussi, malgré les bonnes volontés, des obstacles : en Syrie, les deux pays ont des positions radicalement opposées, l’Arabie saoudite ne cessant de souhaiter le départ de Bachar el-Assad, allié de Moscou ; sur l’Iran, Moscou ne partage pas la vision manichéenne des Saoudiens. Et rien ne laisse penser que les Russes donneront leur confiance aux Saoudiens, et inversement.
Par ailleurs, Moscou n’oublie pas que l’Arabie saoudite est la maison mère du wahhabisme et pense que, malgré les derniers événements, les religieux saoudiens ont une grande responsabilité, au moins morale, dans le développement des mouvements djihadistes à travers le monde, notamment au Caucase (cf. Viatcheslav Avioutskii).
* * *
Bien que les bénéfices d’un éventuel rapprochement soient réels pour les deux parties, la tâche ne sera cependant pas facile. La concurrence est rude, la confiance sera longue à bâtir, les intérêts des deux États sont souvent divergents et la Russie est surtout vue comme « plan B » par les monarchies arabes du Golfe qui préféreront toujours s’appuyer sur les États-Unis, première puissance mondiale. À l’inverse, il n’est pas certain que, malgré les opportunités commerciales, la Russie ait envie d’être entraînée dans ce qui paraît être une nouvelle guerre froide au Moyen-Orient.
Éléments de bibliographie
Avioutskii Viatcheslav, « Nord-Caucase : un “étranger intérieur” de la Fédération de Russie », Hérodote, vol. 1, n° 104, 2002, p. 92-118 (www.cairn.info/revue-herodote-2002-1-page-92.htm).
Cronin Sean, « Idex 2017: UAE and Russia to develop fighter jet », The National [quotidien d’Abou Dabi] 20 février 2017 (www.thenational.ae/business/idex-2017-uae-and-russia-to-develop-fighter-jet-1.612624).
Fattah Zainab, « Guide to $400 Billion in Saudi-U.S. Deals: Black Hawks to Oil », Bloomberg, 22 mai 2017 (www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/guide-to-400-billion-in-saudi-u-s-deals-black-hawks-to-oil).
Fulbright Alexander, « Saudis move toward Netanyahu’s vision on the Palestinians — NY Times », The Times of Israel, 4 décembre 2017 (www.timesofisrael.com).
Jacobs Jennifer, Natter Ari et Dlouhy Jennifer A., « Trump Considers Easing Nuclear Rules for Saudi Project », Bloomberg, 12 décembre 2017 (www.bloomberg.com).
Mandraud Isabelle, « En visite à Moscou, le roi Salman fustige l’Iran, grand rival de l’Arabie saoudite », Le Monde, 6 octobre 2017 (www.lemonde.f).
Manyin Mark E (dir.), Pivot to the Pacific ? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia, Congressional Research Service, Washington, 29 mars 2012, 33 pages (https://archive.org/details/R42448PivottothePacificTheObamaAdministrationsRebalancingTowardAsia-crs).
Reuters, « Saudi Arabia agrees to buy Russian S-400 Air Defense System: Arabiya TV », 5 octobre 2017 (www.reuters.com).
Saudi Press Agency, « Saudi Ambassador to Russia Describes King Salman’s Visit to Russia as Historic », 2 octobre 2017 (www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1673193).
Security Council, « Security Council Discusses Deadly Protests across Iran amid Accusations of Abusing Entity’s Platform to Meddle in States’ Internal Affairs », United Nations, 5 January 2018 (www.un.org/press/en/2018/sc13152.doc.htm).