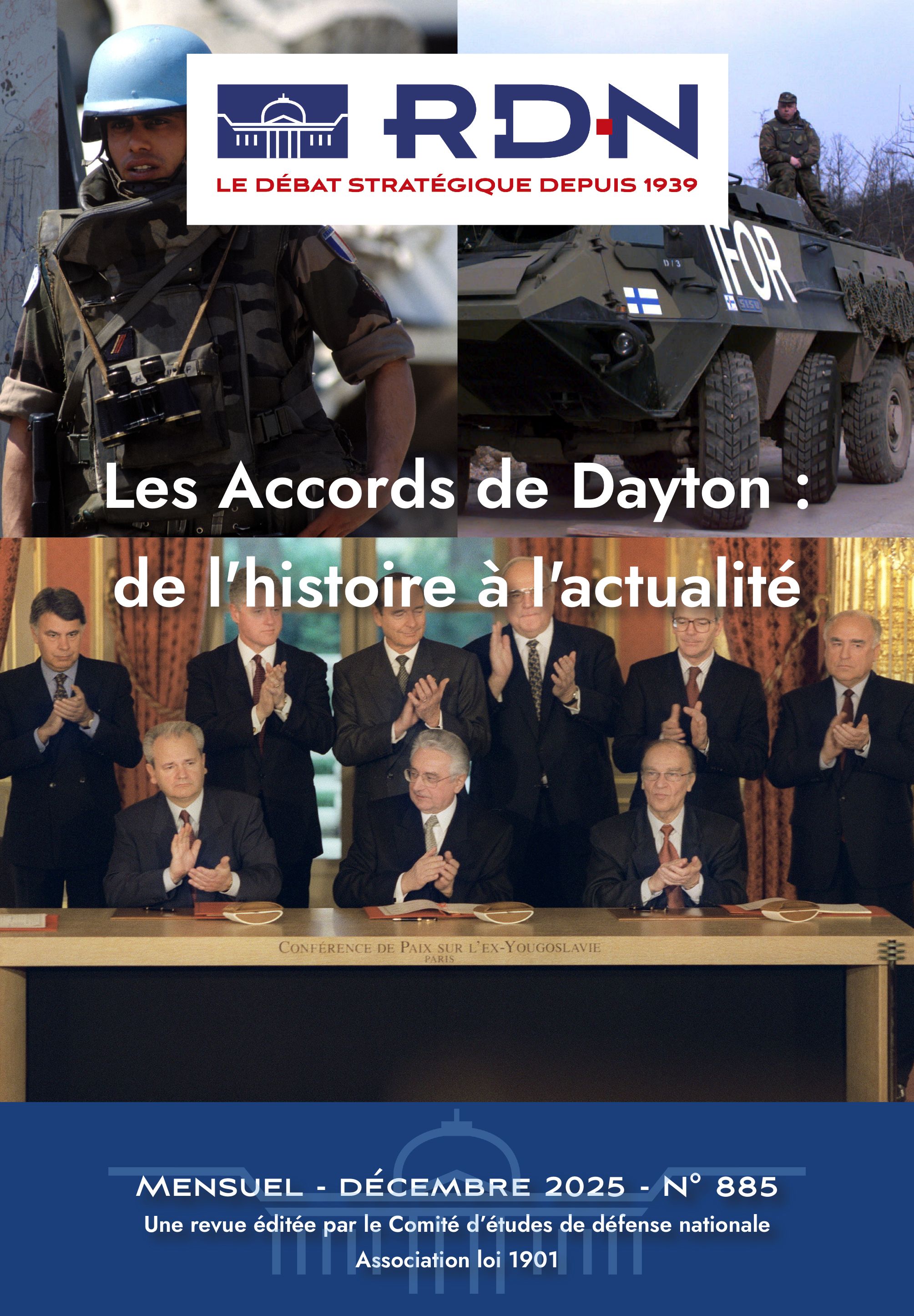Afrique - Afrique de l'Ouest : des secousses à répercussions souterraines - Le coup d'État en Guinée-Bissau met à mal l'idéologie unitaire du PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), mais au profit de qui ?
À l’époque de la colonisation, on les appelait des « enclaves » étrangères parce qu’elles étaient entourées par les pays qui formaient alors l’ancienne Afrique occidentale française (AOF). Ces enclaves sont, du nord au sud, le Sahara occidental, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Liberia, le Ghana et le Nigeria. Le Sahara était espagnol, la Guinée portugaise, le Liberia bénéficiait d’une indépendance protégée par les États-Unis pour le plus grand bénéfice de la Firestone, une société privée américaine. Les autres territoires appartenaient à l’Empire britannique. Avec l’éclatement de l’AOF causé en partie par des rivalités de personnes au sein du Rassemblement démocratique africain (RDA), l’équilibre de la région a basculé en faveur des États anglophones : ceux-ci ont voisiné alors, pour la plupart, avec des pays francophones de même dimension et de capacité équivalente, mais l’importance du potentiel économique et humain du Nigeria a fait peser sur l’ensemble ouest africain, y compris les anciens territoires britanniques, une menace de profond déséquilibre. La crainte d’avoir à subir les effets d’une attraction stérilisante a justifié l’appui que certains apportèrent à la rébellion des Ibos contre le pouvoir central nigérian : ils partaient, sans trop l’avouer, du principe que toute autorité fédérale (le Nigeria était une fédération au même titre que l’AOF en avait été une) empêchait les États qui composaient la fédération d’acquérir une pleine indépendance. Le succès des fédérés a montré que le calcul était faux en ce qui concernait la fédération nigériane, car les 3 États qui la formaient n’étaient pas vraiment monolithiques : il s’est alors avéré que les Ibos s’arrogeaient indûment le droit de parler au nom de toute la population de l’État oriental. Depuis lors, le Nigeria, occupé à panser ses plaies, n’a joué qu’un rôle de second plan dans la politique régionale. Cet effacement relatif ne saurait durer.
Contrairement à ce qu’on peut penser, le Nigeria n’est pas un pays dont la majorité de la population est musulmane. Les statistiques sont à considérer avec quelque méfiance. Le fait que les États du Nord et qu’une partie de ceux de l’Ouest et du Centre sont dominés par des chefs coutumiers musulmans n’implique pas que le peuple soit converti. Toutefois cette circonstance favorise incontestablement la progression de l’Islam. Pour contrebalancer le poids du Nigeria, les pays de l’Afrique de l’Ouest sont en effet contraints de se rapprocher des États du Maghreb, Libye comprise, à l’égard desquels ils ont pourtant éprouvé une méfiance historique. L’Arabie saoudite plus lointaine, moins exigeante, cherche, sans trop d’éclat, quelquefois par l’entremise de son allié soudanais, à prendre la place laissée vacante par le retrait d’Israël dans le difficile équilibre de cette zone. L’Islam est donc présent de tous les côtés, ce qui peut assurer son enracinement, mais il prend des colorations politiques différentes suivant qu’il vient du Sud, du Nord ou de l’Est, le Sud et l’Est ayant toutefois des intérêts communs à défendre contre une poussée perceptible de l’Algérie ou de la Libye. Ces deux derniers pays entretiennent aussi, dans leurs motivations et leurs méthodes de pénétration, des différences qui en font des rivaux.
L’Algérie ne cherche pas à déstabiliser la région ni à se mêler des affaires intérieures des pays qui en font partie, du moins tant que l’intervention trop visible d’un autre État ne lui en donne pas le prétexte, ou qu’elle ne croit pas ses intérêts vitaux directement menacés comme, par exemple, dans l’affaire du Sahara occidental. Son désir d’expansion est lié à la politique économique qu’elle s’est efforcée de mettre sur pied depuis 1965. Estimant que, par sa position géographique et le degré d’évolution globale de sa population, elle peut avoir vocation de devenir l’intermédiaire entre l’Europe hyper-industrialisée et le monde africain des matières premières, elle s’est efforcée d’occuper cette place, sans grand succès jusqu’ici, puisque ses relations avec l’Afrique ne dépassent pas 3 % à l’exportation et 4 % à l’importation de son commerce extérieur. En revanche, elle a su méthodiquement implanter, dans ses départements sahariens, un réseau routier dont l’axe principal est la route Alger-El Golea-In Salah-Tamanrasset. De la capitale du Hoggar divergent 2 rocades, l’une en direction de Gao, d’où elle pourra rejoindre la route Mopti-Abidjan déjà construite, l’autre vers Agadès et le Nigeria. La « route de l’unité africaine », comme on l’appelle à Alger, verra sa partie algérienne terminée en 1983, mais les pays subsahariens ont choisi jusqu’ici d’orienter leurs réseaux de communication vers l’océan plutôt que vers les voies transsahariennes, bien qu’Alger eût proposé, notamment au Niger, de participer au financement des travaux. Les experts, tant algériens que nigérians et européens, ont pourtant démontré que, même si les ports de la côte n’étaient plus régulièrement saturés, l’établissement de transports réguliers transsahariens s’avérerait économiquement rentable pour desservir toutes les régions situées à plus de 1 000 kilomètres d’un port océanique.
Il reste 78 % de l'article à lire
Plan de l'article