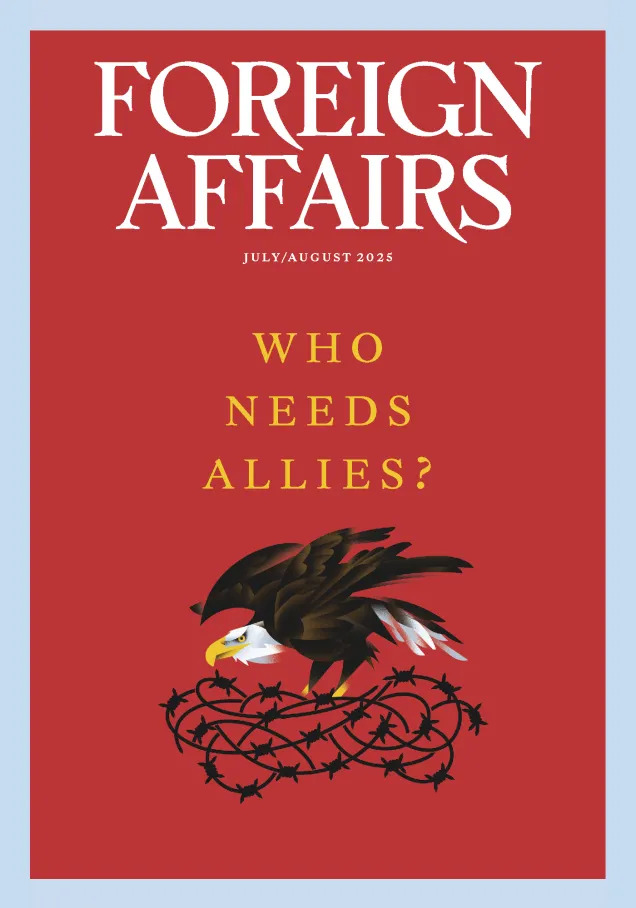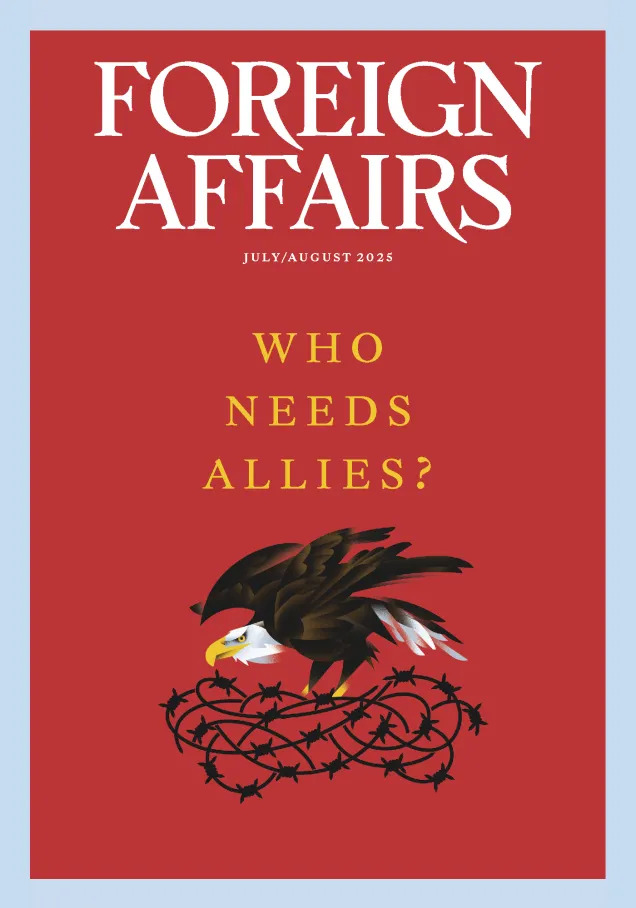
Foreign Affairs, juillet-août 2025, vol. 104, n° 4
Dans sa nouvelle édition « Parmi les revues », la RDN propose l'analyse de Guy Vinet d'un article paru dans le journal américain Foreign Affairs, décryptant la politique étrangère de Donald Trump. Il propose une lecture et une interprétation de la politique étrangère du président Trump, à l'écart du discours ambiant et général trop souvent entendu en Europe et en France. Les auteurs déchiffrent la stratégie américaine et l'articulent autour du paradigme de la priorisation.
Among the Journals —Strategies of Prioritization. American Foreign Policy After Primacy, Foreign Affairs
In its new edition, "Among the Journals," the RDN offers Guy Vinet's analysis of an article published in the American journal Foreign Affairs, deciphering Donald Trump's foreign policy. It offers a reading and interpretation of President Trump's foreign policy, outside the general and ambient discourse too often heard in Europe and France. The authors decipher the American strategy and articulate it around the paradigm of prioritization.
Vue d’Europe en général et de France en particulier, la politique étrangère du Président américain Donald Trump peut sembler tour à tour confuse, erratique et inquiétante. Depuis le début de son second mandat, en janvier 2025 et avant, les décisions qu’il a annoncées puis prises en ce domaine ont pu paraître abruptes, inconséquentes, voire irrationnelles. Son comportement versatile et parfois vindicatif soutenu par une mise en spectacle permanente a provoqué l’incertitude de ses partenaires. Il s’agit là d’appréciations rapides qui mêlent réactions épidermiques, conformisme et méconnaissance.
La réalité est sensiblement différente, comme nous l’expliquent Jennifer Lind et Daryl G. Press dans la livraison de juillet-août de la revue américaine Foreign Affairs (1).
En quelques semaines, l’administration Trump a menacé d’annexion le Canada, le Groenland et Panama, a augmenté les tarifs douaniers de manière drastique et se répand en critiques acerbes sur ses alliés traditionnels. Ces décisions, d’abord craintes, ont désarçonné de nombreux pays de par le monde comme l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine ou l’Inde, mais ont surtout déstabilisé les alliés européens. Ces derniers ont, par diverses tactiques, individuelles ou collectives, tenté d’amadouer l’hôte de la Maison Blanche, en vain.
Il reste 86 % de l'article à lire
.jpg)