Le nucléaire militaire – mémoire stratégique (Complément du numéro d'été 2015)
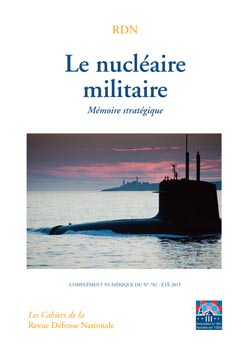
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l’issue de la capitulation du Japon après les deux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, la Revue Défense Nationale, qui avait repris sa publication en juillet 1945, s’est intéressée et a travaillé sur la question nucléaire. Le nombre d’articles publiés sur ce sujet est impressionnant et reflète la dimension centrale du fait nucléaire depuis soixante-dix ans. La revue a fait non seulement écho, mais a directement contribué au débat et à l’élaboration de la doctrine française autour de la Bombe, tant sous la IVe République, alors que la France en était aux balbutiements de ses programmes nucléaires et civils, que sous la Ve République quand la dissuasion est devenue la pierre angulaire de notre politique de défense. Tous les aspects ont été abordés dans la revue. Les enjeux technologiques, politiques, doctrinaux, éthiques… ont fait l’objet de papiers variés permettant de voir une progression des réflexions sur ces enjeux. Lire la suite
D’abord, il est bien peu vraisemblable que, dans l’avenir, le secret de la bombe atomique restera l’apanage d’une seule nation, à savoir des États-Unis, qui le détiennent en ce moment. Il est probable au contraire que tous les peuples travailleront intensément la question, lançant leurs savants et leurs inventeurs sur cette piste et consacrant à cette recherche des crédits très élevés. On est donc en droit de penser que tout le monde ou presque, au moins les États possédant un potentiel scientifique, industriel et financier assez développé sauront et pourront confectionner des bombes atomiques, et que cette fabrication passera assez vite dans un domaine relativement public. En conséquence, la nation qui a trouvé à l’origine la recette de mise au point de l’outil n’obtiendra, de ce fait, qu’un avantage essentiellement passager et éphémère. Elle ne détiendra aucun monopole indéfini à cet égard et il n’en résultera pas pour elle la possibilité permanente, au choix, ou bien d’exercer sur le monde une hégémonie totale, ou bien de faire régner sur lui une paix dominatrice analogue à la pax romana de jadis (1). Lire les premières lignes
Le 21 janvier dernier, le sous-marin Nautilus, premier bâtiment utilisant pour sa propulsion l’énergie nucléaire, a été lancé à Groton, Connecticut. Cette date mérite d’être retenue, car elle marque, pour la marine, l’avènement de l’ère atomique. Plus encore peut-être que son emploi comme explosif, l’utilisation de l’énergie nucléaire pour la propulsion des navires laisse présager, dans le domaine de la stratégie navale, des répercussions qui pourraient bien être aussi considérables que celles provoquées par l’introduction de la vapeur au XIXe siècle. Lire les premières lignes
Les armes atomiques constituent désormais le facteur de force le plus puissant dans le monde, bien qu’il ne soit à la disposition que d’un petit nombre de grandes puissances. Il existe dès maintenant des quantités importantes et rapidement croissantes de ces armes, qui représentent un potentiel de destruction en augmentation constante. Jusqu’à la réussite des essais thermonucléaires américains et soviétiques, on pouvait supposer que cette augmentation serait limitée par un goulot d’étranglement : la production d’uranium naturel. On pouvait, en effet, estimer qu’étant donné les ressources probables en minerais de ce métal, il serait possible de produire au total dans le monde, environ 2 500 bombes atomiques de fission par an, ce qui n’était pas négligeable et aurait conduit au bout de quelques années à l’accumulation de stocks déjà respectables. Certes, ce chiffre était susceptible de s’accroître largement dans l’avenir par application du principe du breeding et par l’utilisation comme matière explosive de l’isotope de masse 233 de l’uranium obtenu, dans les réacteurs, à partir du thorium. Lire les premières lignes
Il est curieux de constater qu’il subsiste encore à l’heure actuelle dans beaucoup de bons esprits un large degré d’incompréhension de l’unité que présentent dans leur nature et dans leur emploi les armes nucléaires et les autres, c’est-à-dire les armes dites « classiques » ou « conventionnelles ». C’est ainsi que l’on entend fréquemment opposer entre elles les forces nucléaires qui seraient destinées à la guerre d’écrasement général et les forces conventionnelles, qui seraient, elles, capables de mener des guerres plus « humaines », analogues aux dernières guerres mondiales, pour autant que celles-ci puissent être considérées comme ayant été humaines puisque des dizaines de millions d’hommes y ont disparu et que des destructions immenses y ont eu lieu. Lire les premières lignes
La réalisation de réacteurs nucléaires de propulsion navale est certainement l’événement capital de l’après-guerre pour les marines qui ont su résoudre les nombreux problèmes, délicats et complexes, posés par cette nouvelle technique. La propulsion nucléaire a provoqué, en effet, une véritable mutation du sous-marin en lui conférant toutes les qualités que les moteurs classiques étaient incapables de lui donner : l’autonomie en plongée – qui n’est plus limitée que par le facteur humain – et la discrétion qui en découle, une puissance propulsive élevée permettant une vitesse en plongée égale à celle des bâtiments de surface, une endurance très supérieure à celle des moteurs Diesel légers utilisés jusque-là. Lire les premières lignes
Note de la rédaction : L’exposé qui suit doit beaucoup aux travaux que, dès 1965, des officiers français entreprirent pour l’étude d’un modèle logique de dissuasion.
Lire les premières lignes
En procédant dorénavant en site souterrain à ses expériences nucléaires, la France n’entend pas abandonner sa position juridique concernant le droit à la possession d’un armement nucléaire et à sa mise au point. L’auteur – un spécialiste du droit international en ces matières – rappelle cette position et en fait saisir les nuances. Il aborde ensuite le problème du jus cogens, ce droit contraignant que certains voudraient tirer des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies et du droit coutumier. La France récuse ce procédé car elle y voit une nouvelle possibilité de manœuvre contre ses essais même souterrains. Lire les premières lignes
Note préliminaire : Le texte qui suit est la reproduction, dans sa forme orale improvisée, d’une conférence prononcée par l’auteur à l’occasion de l’ouverture du cycle annuel du Cours supérieur interarmées. L’auteur livre ses réflexions sur l’évolution et la validité de la notion traditionnelle de rapport de forces (1).
Lire la suite
Je me propose, comme souvent dans ces sortes de conférences, de commencer par des analyses, relativement abstraites, à la fois du vocabulaire et des théories, pour aborder le problème le plus difficile qui domine la pensée militaire française, mais que l’on a rarement le courage d’aborder franchement. Ce problème est le suivant : Comment peut-on concilier la participation française à l’Alliance atlantique avec l’affirmation d’une défense autonome fondée sur la dissuasion ? Lire les premières lignes
Des terroristes seront-ils un jour prochain capables de menacer nos États démocratiques d’une déflagration atomique ? Le terrorisme nucléaire ne constitue-t-il pas un des risques majeurs de cette fin de siècle ? S’agit-il au contraire d’un mythe sans guère de fondement ? Nous avons demandé à Jean-Louis Dufour, spécialiste de la conflictualité contemporaine, consultant militaire de quelques grands médias, auteur en particulier, et avec Maurice Vaïsse, de La guerre au XXe siècle (dont nous avons rendu compte dans notre livraison de janvier 1994), de tenter de répondre à ces questions. Lire les premières lignes
Il peut paraître prétentieux de traiter de ce sujet alors que les nouvelles menaces, qui sont apparues depuis la fin de la guerre froide, de toute évidence ne relèvent pas de la dissuasion nucléaire, que l’« empire du mal » qui en avait été la raison d’être, s’est effondré, et que l’avenir des relations internationales est plus incertain qu’il n’a jamais été. Or nous savons, pour nous y être essayé autrefois sous l’égide des maîtres de l’époque, que la prospective est une science encore plus inexacte que la météorologie, et que les « tendances lourdes » sur lesquelles elle s’appuie ne préjugent que bien rarement le long terme ; aussi nous bornerons-nous ici à explorer le moyen terme, c’est-à-dire l’avenir des deux prochaines décennies. D’autre part, si nous nous sommes efforcé de recueillir nos informations aux meilleures sources, nous n’avons pas eu accès, bien évidemment, aux secrets qui couvrent dans notre pays, plus que dans d’autres, le nucléaire militaire. Notre seule qualification pour l’aborder sera donc d’avoir été un observateur attentif de la naissance aux États-Unis du concept de dissuasion, puis de son adoption en France, ainsi que de la création et du développement des forces chargées de le mettre en œuvre, au point d’avoir entrepris d’en écrire l’histoire, après avoir recueilli les témoignages de la plupart de leurs acteurs encore en vie. Cette intimité de plus de quarante ans avec le sujet nous a aussi amené à faire part périodiquement de nos réflexions sur son évolution aux lecteurs de cette revue, et cela à la seule fin d’animer leurs propres réflexions. Tel est donc encore notre propos ci-après. Lire les premières lignes
De Gaulle, stratège nucléaire (mai 2009) - Bruno Tertrais - p. 141-146
Le général de Gaulle n’a pas seulement fait passer la France du statut de puissance nucléaire « virtuelle » à celui de puissance nucléaire « opérationnelle ». Il est également le véritable père de la stratégie nucléaire française. Il a en effet réalisé une synthèse entre les différents courants et écoles de pensée qui se manifestaient à l’époque. Et sa vision, dans ce domaine, était beaucoup plus ouverte et pragmatique que celles qui étaient exprimées par les théoriciens français des années 60 tels que les généraux Ailleret, Beaufre, Gallois et Poirier. Lire les premières lignes









