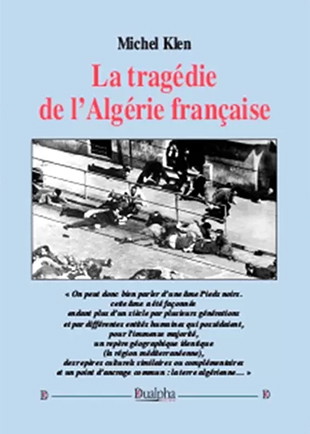
Saint Cyrien de 1966, Michel Klen analyse en détail les événements de la guerre d’Algérie et souligne avec neutralité tous les traumatismes qui ont entraîné la fin de l’Algérie française. Remontant dans le passé, il rappelle l’enlèvement des Chrétiens par les pirates barbaresques, la vente frauduleuse de blé au Directoire, l’opposition des Arabes à l’agriculture (selon Tocqueville), les hésitations de Bugeaud, l’approbation de la colonisation par Victor Hugo et Ferhat Abbas. Lire la suite
Né en 1956 à Sétif, Mohand Hamoumou est le fils d’un harki qui disparut la même année en Algérie. Un de ses oncles et son beau-frère sont également harkis, alors que trois autres de ses oncles ont pris parti pour la rébellion. Ayant rejoint la France en 1962 avec son beau-frère, il séjourne successivement dans les camps du Larzac et de Rivesaltes, et dans un hameau forestier en Dordogne, avant de se fixer en Auvergne. Il fait alors de brillantes études au lycée de Riom, à l’École normale et à l’université de Clermont-Ferrand (psychologie, droit, sociologie), avant d’entrer à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) en 1986. Après avoir été instituteur, chercheur et enseignant en faculté, il est actuellement cadre de direction chez Michelin. Lire la suite
Depuis des années, le général Maurice Faivre participe à la rédaction de notre revue, et c'est au tout début de 1988 qu'il prit en charge la chronique « Défense en France ». Ses connaissances, sa compétence, ses multiples rencontres, sa méticulosité lui ont permis de nous apporter des informations d'une qualité exceptionnelle, souvent inédites, faisant taire les on-dit lancés à la cantonade suivant le sujet à la mode et l'humeur du moment. Le général Faivre nous quitte, mais continue à s'intéresser personnellement à toutes ces questions auxquelles il a consacré tant de temps. Nous le remercions vivement de son inestimable collaboration.
Le débat électoral a été l’occasion pour les hommes politiques d’aborder le problème du Service national. Sans le supprimer totalement, certains ont proposé d’en réduire encore la durée, de le transformer en garde nationale, ou en service civique auquel seraient astreintes les jeunes filles. L’État-major n’a pas manqué d’étudier ces différentes options, et la Direction centrale du Service national a publié fin avril son bilan 1992. Lire la suite
Créé sur proposition du Chef d’état-major des armées (Céma) par décision ministérielle du 24 octobre 1991, le Collège interarmées de défense (CID) ouvre ses portes le 1er septembre 1993 à l’École militaire, sous la direction du vice-amiral Marc Merlo. Il regroupera pendant un an, au sein d’une même promotion, en vue d’un enseignement à dominante interarmées, les futurs brevetés de l’Enseignement militaire supérieur du 2e degré des armées, soit 280 à 300 stagiaires, dont 110 étrangers (voir chronique de juillet 1992). Lire la suite
La plus grande partie des archives de la guerre d’Algérie a été ouverte au public le 1er juillet 1993, conformément à la loi du 3 janvier 1979, et pour les armées, au décret du 3 décembre 1979. Lire la suite
Au cours d’une carrière militaire partagée entre le commandement opérationnel et territorial, l’état-major et l’enseignement supérieur, le général Fiévet s’est fait remarquer par sa capacité de réflexion, la clarté de son expression et son sens pédagogique. Il met ensuite les mêmes qualités au service de grandes entreprises, aux cadres desquelles il expose les fondements de la stratégie. Il professe actuellement un cours trimestriel à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec), sur le même thème. Ce livre, qui a obtenu en 1992 le prix des Affaires, nous restitue son enseignement. Lire la suite
La Fondation pour les études de défense nationale (FEDN), dont un communiqué ministériel du 24 décembre 1992 a annoncé la dissolution prochaine, a été créée en 1972 par le ministre Michel Debré, dans le but de « susciter, encourager et effectuer des études et des recherches sur les problèmes de doctrine militaire, de stratégie et de défense ». Elle devait également « développer l’information en favorisant ou prenant en charge la publication et la diffusion d’écrits en ce domaine, faire effort sur l’enseignement, organiser enfin des rencontres et des colloques » sur ces problèmes. Lire la suite
Économiste de formation, Gérard-François Dumont a été converti à la démographie par son maître Alfred Sauvy, et après avoir présidé l’Association pour la recherche et l’information démographique (APRD), il a dirigé au Collège de France un séminaire de « démographie politique ». Admis par concours aux fonctions professorales, il enseigne à la Sorbonne (faculté de géographie, 191 rue Saint-Jacques). Lire la suite
Alors que la loi de programmation 1992-1994 fixe à 308 milliards les crédits d’équipement, le « référentiel de 1997 » prévoit 662,4 Md de crédits en 6 ans. Si l’on en soustrait les fonds de concours (3 Md hypothétiques), on arrive à une moyenne de 103 Md de francs 1992 par an. Cette stabilité nominale est cependant toute théorique, puisque les annulations de crédits de 1992, imposées par le surcoût des opérations de maintien de la paix, s’élèveront à 3,25 Md, portant précisément sur le Titre V. On comprend que l’amiral Lanxade ait exprimé l’inquiétude des armées de voir restreindre leur marge de manœuvre, « au moment où il devient urgent de moderniser nos forces conventionnelles » ; il souhaite donc que la croissance du budget militaire « soit du même ordre que la croissance économique » (1). De son côté, le rapporteur de la Commission des finances à l’Assemblée a exprimé le vœu que des crédits prévisionnels soient inscrits au budget pour faire face aux retards de paiement de l’ONU, qui atteignent 18 à 24 mois. Lire la suite
Tous les ans, l’Observatoire social de la défense établit un bilan dont un des chapitres est consacré à l’Action sociale des armées (ASA). De son côté, la sous-direction des actions sociales du ministère publie un bulletin trimestriel (Bus), des articles et des notices qui font le point des résultats obtenus et des améliorations envisagées. La lecture de ces documents suggère l’idée que l’ASA est devenue un élément majeur de la politique des personnels de la défense. Lire la suite
La Direction centrale du service national a dû faire face à une forte augmentation des reports d’incorporation, provoquée par l’annonce du service à 10 mois. Au 1er mars, ces reports s’élevaient à 1,145 million, après avoir doublé en 10 ans (32 à 66 % de la ressource). Il en est résulté des déficits d’incorporation de 27 000 et environ 15 000 aux premiers semestres de 1991 et 1992. Au 2e semestre de 1991, les besoins ont été satisfaits sans difficulté, alors que pour le 2e semestre de 1992 la ressource devrait être excédentaire de 10 000 à 15 000 appelés. Lire la suite
Deux organismes ont été créés par décrets du 16 juin 1992 : la Direction du renseignement militaire (DRM), et la Délégation aux affaires stratégiques (DAS). Cette dernière en fait n’est pas nouvelle, puisqu’elle remplace la Délégation aux études générales (DEG), créée en 1987 par M. Giraud pour coiffer le groupe de planification et d’études stratégiques (Groupes) de M. Hernu, qui lui-même remplaçait le centre de prospective et d’évaluation (CPE) de M. Messmer. Ces modifications sémantiques ne semblent pas avoir transformé la mission des organismes dissous, qui étaient chargés d’étudier les problèmes de stratégie, d’apprécier les options possibles à long terme, de participer à la programmation des armements. Les textes des décrets successifs reprennent sensiblement les mêmes expressions. La seule innovation de la DAS consiste en sa fonction de conseiller du ministre pour les négociations internationales et la coopération. Lire la suite
Les 13 et 14 mai, s’est tenu à Saint-Cyr-Coëtquidan un colloque international sur la formation initiale des officiers. Il faisait suite à un séminaire de recherche dirigé en 1990-1991 par le contrôleur des armées Hoffmann, consacré à la comparaison des systèmes de formation dans neuf pays alliés, dont la France. Le colloque rassemblait des représentants de ces pays, des écoles des trois armées et de la Gendarmerie, de l’administration centrale et de l’université. Le chef du contrôle des armées et le secrétaire général pour l’administration concluaient les débats. Lire la suite
Les mesures de restructuration pour 1993 ont été annoncées par le ministre, du 10 au 16 avril 1992, successivement aux préfets, aux généraux chargés de commandement, aux commissions parlementaires de la défense, puis à quelques journalistes choisis. Ces mesures s’inscrivent dans le plan de modernisation des armées, destiné à les mettre en mesure de remplir leurs nouvelles missions (voir chronique d’avril), en même temps qu’à réduire les effectifs et les coûts. Il ne s’agit là que d’une première étape, l’objectif à moyen terme étant lié à la loi de programmation (voir chronique de janvier), qui pourrait être retardée et raccourcie de deux ans. Lire la suite
La chronique de novembre 1989 établissait le bilan des résultats obtenus par le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) depuis sa création en 1969. Tout à fait positif pour la première décennie de son activité, qui lui avait permis d’adopter et d’amender le statut général et les statuts particuliers des militaires, ce bilan était moins favorable pour la deuxième décennie, en raison de la courte durée des sessions, de l’intérêt mineur des textes proposés, du manque de motivation et d’initiative des participants désignés par le sort. La majorité des militaires pouvait alors leur reprocher de n’avoir rien obtenu pour l’amélioration de leur condition. Lire la suite
En quelques mois, les armements français ont concrétisé de notables avancées. En mai et décembre 1991, les prototypes du Rafale versions air et marine ont effectué leur premier vol. Le même mois de décembre, ont été réalisés le lancement du système de télécommunications Syracuse et le premier tir du missile stratégique M45. En janvier 1992, la coque du porte-avions Charles-de-Gaulle a été achevée, et le premier char Leclerc de série, fabriqué par le Groupement industriel des armements terrestres (Giat), a été transféré à la Délégation générale pour l’armement (DGA) pour y poursuivre son expérimentation. Les importantes améliorations apportées dans la technologie de ces matériels majeurs entraînent des contraintes de coût qui influeront sur les délais de livraison et sur les quantités fabriquées. Lire la suite
On pouvait penser que tout avait été dit sur la guerre du Golfe. Un an après le déclenchement de l’attaque aérienne contre l’Irak, Claude Le Borgne nous démontre qu’il n’en est rien. Commentateur avisé des événements diplomatiques et militaires de cette crise, il les éclaire de la profonde connaissance de l’Orient islamique, de la technique militaire, et de ses réflexions sur la philosophie de la guerre. Lire la suite
Dernier commandant du 1er corps d’armée de Metz dissous à l’été 1990, et ayant commandé simultanément la 6e région militaire d’avant la réorganisation de 1991, le général de corps d’armée Clarke de Dromantin était bien placé pour débattre de l’Armée de terre dans une logique globale de défense qui tienne compte des leçons de la guerre du Golfe, de l’évolution de la situation internationale et des risques qu’elle engendre. Lire la suite
L’Observatoire social de la défense (OSD) a publié cet été son bilan social 1990, en nette amélioration dans sa présentation et son contenu. Outre les effectifs par catégorie, grade, sexe, âge, etc., les recrutements et les départs, les promotions, mutations et rémunérations, et les résultats de l’action sociale, on y trouve de nouvelles rubriques telles que les circonstances des départs avec ou sans pension, les bilans de la formation des appelés, et les débats au sein des organismes de concertation (Conseil supérieur de la fonction militaire [CSFM], commissions paritaires, conseil permanent des retraités). On citera par exemple : Lire la suite
Deux décrets du Premier ministre et 20 décrets du ministre de la Défense, désigné dans les textes comme « ministre chargé des Armées » ont été promulgués le 14 juillet 1991. Ils modifient à partir du 1er septembre l’organisation territoriale de la défense et mettent fin à l’expérimentation conduite en 5e Région militaire (RM), dont la durée aura été écourtée. Lire la suite
Ancien auditeur à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), membre du Centre d’études de défense et de sécurité internationale (CEDSI) de Grenoble, collaborateur de la revue Défense Nationale, Daniel Colard enseigne le droit international à la faculté de Besançon. Il vient de rééditer pour la 4e fois son manuel de Relations internationales, profondément augmenté et modifié par rapport aux éditions précédentes. Lire la suite
La Communauté européenne enregistre parfois des succès sur le plan pratique. L’adoption de la Convention de Schengen sur la libre circulation des personnes en témoigne. Toutefois, il aura fallu près de cinq ans de pourparlers pour parvenir à un accord. Combien de temps s’écoulera finalement avant qu’un compromis soit obtenu sur l’Union politique ? Il ne sera guère aisé d’ajuster les compétences du Conseil européen, de la Commission de Bruxelles et de l’Assemblée de Strasbourg, et encore plus difficile de faire le partage entre les aspirations supranationales de ces dernières et la logique interétatique du Conseil. Lire la suite
Annoncé par le président de la République à l’issue de la guerre du Golfe, le débat sur la politique de défense s’est tenu à l’Assemblée dans la soirée du 6 juin 1991. En dépit d’une assistance clairsemée, il a donné un premier aperçu des positions du gouvernement et des partis, avant le débat sur la loi de programmation, prévu pour la fin de l’année. Lire la suite
La chronique d’avril 1990, consacrée aux Élèves officiers de réserve, faisait état des efforts entrepris depuis 1988 par l’Armée de terre pour recruter des EOR de haut niveau. Cette action faisait suite au constat de désaffection des élites pour le service militaire, constat qui sera confirmé l’année suivante par le rapport Chauveau (1). Lire la suite
Colloques, manifestations, expositions...
Institutions, ministères, médias...