Europe : fin de l'innocence stratégique – Regards du CHEM - 74e session
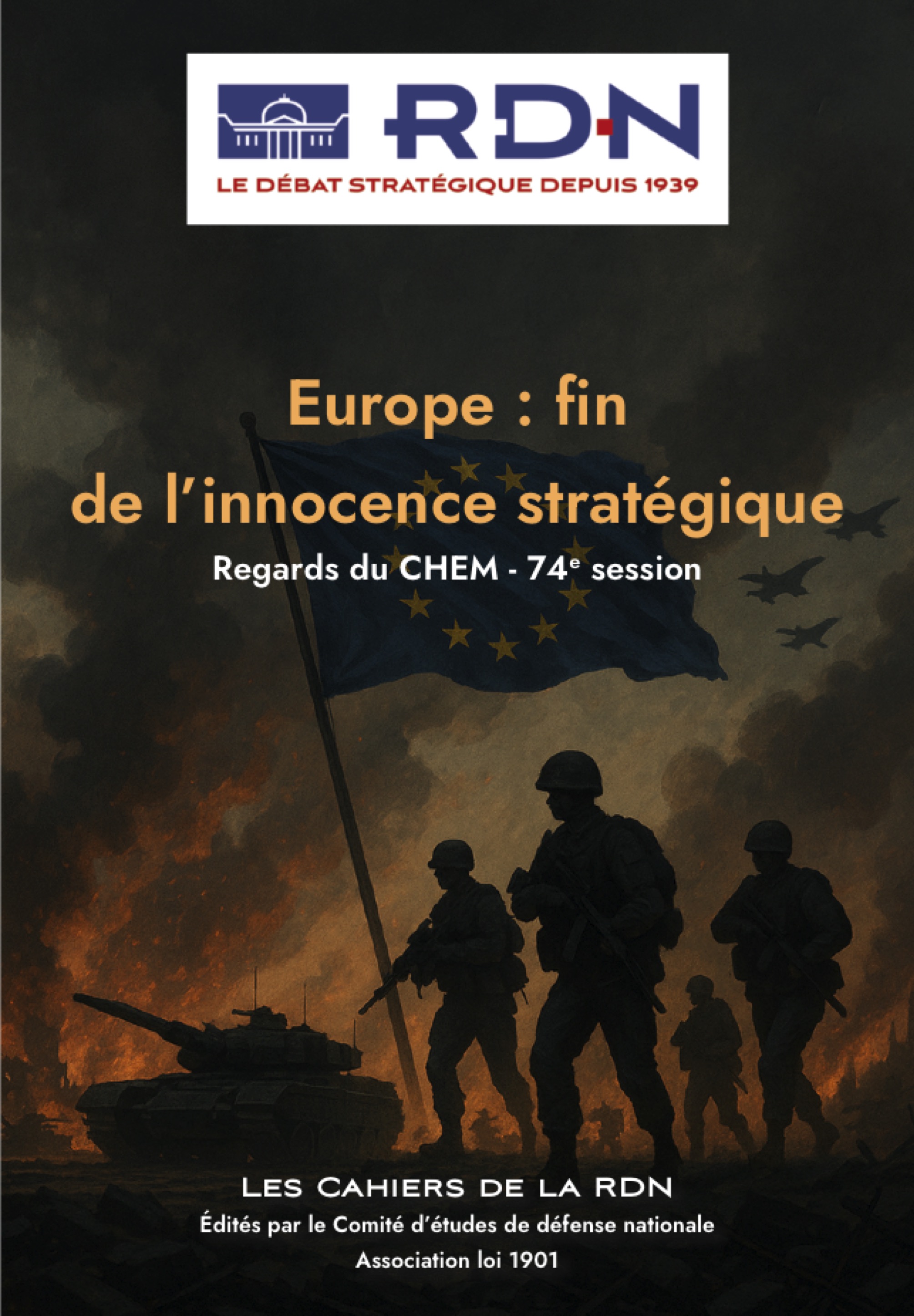
Ce Cahier de la RDN ouvre ses colonnes aux auditeurs de la 74e session du Centre des hautes études militaires (CHEM).
Après la formidable réussite qu’a représentée sa réunification à l’issue de la guerre froide, l’Europe saura-t-elle négocier le tournant géostratégique qui est en train de redéfinir l’équilibre des puissances ? Dans tous les domaines elle est bousculée dans ses fondements, dans ses valeurs. Épuisée par deux guerres mondiales qui l’ont laissée exsangue, ayant renoncé difficilement à ses ambitions impériales, elle s’est détournée de la puissance, du hard power, pour se concentrer sur le « doux commerce » cher à Montesquieu (1), confiante dans son projet ambitieux de construction communautaire et dans la capacité de son allié américain à la préserver des puissances qui menaceraient son existence. Toutefois, cet allié est maintenant concurrencé dans son leadership et le modèle politique qu’il porte est lui aussi contesté par ceux, Chine, Russie, Iran en tête, qui ont intérêt à remettre en cause le statu quo issu de la guerre froide. Lire la suite
Le défi politico-militaire pour les armées et la société
L’idée de la bataille décisive, qui a réellement pris corps au XIXe siècle, influence encore notre façon de penser la guerre. Si cette idée nourrit nos mythes fondateurs et repose sur notre culture philosophique hellénistique, elle n’en demeure pas moins limitative et nous conduit dans des impasses stratégiques. Il apparaît alors nécessaire de repenser les conflits armés comme des « transformations » de rapports de force. En s’appuyant sur la notion de « propension », au sens de la philosophie orientale, sur les forces morales dans le temps long et sur l’importance de la puissance politique, nous pourrons alors réellement transcender l’idée de la bataille décisive et affirmer ainsi que « tout est politique ». Lire la suite
Face à une dégradation sécuritaire historique, cet essai plaide pour un réinvestissement des anciens militaires dans le débat public français, afin de contribuer au nécessaire réveil du pays face au risque de guerre. Historiquement présents dans les sphères décisionnelles, puis marginalisés depuis la guerre d’Algérie, ces profils sont pourtant des atouts précieux pour l’action publique par l’expérience acquise et leur sens de l’intérêt général. Des initiatives récentes de l’État montrent la voie d’une reconversion productive, mais elles doivent encore surmonter des résistances culturelles et administratives. L’enjeu n’est pas une militarisation de la République, mais une optimisation des parcours, dans une logique de résilience nationale. Lire la suite
L’opération Sagittaire, conduite au Soudan en avril 2023, a permis d’évacuer 1017 ressortissants de 84 nationalités, dont 225 Français. Planifiée et conduite par les forces françaises stationnées à Djibouti, l’opération a été unanimement considérée comme un succès stratégique. Comme pour toute stratégie militaire, c’est la parfaite combinaison des facteurs espace, temps et force qui a permis d’emporter la décision. Cela ne peut être précédé que d’une volonté politique et d’une capacité du diplomate et du militaire à agir ensemble en acceptant une nécessaire prise de risque dans la conduite des opérations. Lire la suite
Ernest Renan définit la nation comme une « âme » et un « principe spirituel » à la fois, témoignant en démocratie d’un lien quasi transcendantal entre la cohésion nationale et l’efficacité militaire. Parce que la volonté générale porte le destin national, elle confère à son armée sa puissance matérielle et immatérielle. Or les leçons de l’histoire nous alertent sur la précarité de ce lien et le risque existentiel pour la nation si l’on néglige l’un ou l’autre de ces facteurs stratégiques. À l’heure où de nouvelles menaces, tant endogènes qu’exogènes, malmènent notre pays, il importe à l’État, à l’armée et à la population d’entrer en stratégie afin de revigorer le contrat social et ainsi garantir la survie de la France. Lire la suite
L’agression russe en Ukraine préoccupe les Français mais, lorsque le conflit a eu un impact économique en France, les débats nationaux se sont recentrés sur le pouvoir d’achat. Alors que la Russie cherche à détruire notre modèle démocratique et social, ainsi que notre prospérité, sommes-nous vraiment prêts à nous battre ? Pour mobiliser les Français, il faut décrire précisément les objectifs et les modes d’action russes contre notre pays. A cette prise de conscience doivent s’allier des mesures de lutte contre la désinformation et de renforcement de la cohésion nationale. En mettant l’accent sur les forces morales de sa population, la France pourra fonder un effort durable en faveur de sa sécurité et de la préservation de son modèle politique et social. Lire la suite
Réflexions sur le futur modèle d'armée
Dans son dernier ouvrage intitulé Vers la Guerre ?, le ministre des Armées a insisté sur le risque d’être « défaits sans être envahis ». Ces termes sous-tendent l’hypothèse d’agressions qui contourneraient par le bas notre dissuasion, en exploitant une forme d’opacité que confèrent les champs cyber, informationnel, spatial ou sous-marin. À moyen terme, les ambitions stratégiques que la France a développées au cours des dernières années permettront de faire face à l’émergence de ces menaces dans les zones grises. Ces efforts s’inscrivent selon une stratégie globale qui intègre une dimension de défense active, des démarches d’anticipation ainsi qu’une logique déclaratoire, sans négliger la résilience de la Nation. Lire la suite
L’esprit corsaire, figure hybride entre autonomie et loyauté, éclaire utilement les formes diffuses de la conflictualité contemporaine. À l’heure des guerres informationnelles, des ressources militaires limitées et du brouillage des lignes entre public et privé, cet article explore comment les Entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD) et les réseaux civils peuvent prolonger l’action de l’État. Il ne s’agit ni de duplicité ni de privatisation incontrôlée, mais d’adopter une posture agile, encadrée et réversible, au service de l’intérêt national. Loin de la nostalgie, l’esprit corsaire devient un levier de souplesse et d’initiative dans les zones grises de la compétition mondiale. Lire la suite
Alors que les États-Unis redéfinissent leur priorité stratégique vers l’Indopacifique, l’Europe fait face à un déficit croissant potentiel de dissuasion conventionnelle. La France, limitée par sa doctrine nucléaire et ses contraintes budgétaires, ne peut égaler les capacités américaines. Elle devrait plutôt capitaliser sur ses atouts maritimes et expéditionnaires. En adaptant à ses besoins les concepts EABO et SIF des Marines américains, elle pourrait déployer des forces littorales agiles, capables de refuser l’accès à l’adversaire et de renforcer la posture maritime de l’Otan. Cette stratégie est à la fois crédible, abordable et conforme à l’autonomie stratégique française. Lire la suite
Les grands fonds marins, longtemps considérés comme des espaces inaccessibles et mystérieux, émergent aujourd’hui comme un enjeu stratégique majeur pour la France et les autres puissances maritimes. La France, avec la seconde plus grande zone économique exclusive au monde, se trouve dans une position privilégiée pour jouer un rôle de premier plan dans l’exploration et la gestion de ces espaces. La stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins lancée en 2022 a permis à la France d’amorcer une réponse capacitaire pour adresser les nouveaux enjeux de ce milieu de plus en plus contesté. La dynamique est bonne mais son élargissement et son accélération s’imposent au regard de l’activité croissante de ses compétiteurs. Lire la suite
L’espace est au cœur des équilibres militaires, technologiques et géopolitiques mondiaux. Il est un lieu de confrontation indirecte de puissance tant sa maitrise procure un atout considérable en matière de défense et de sécurité. Acteur historique de premier rang dans ce domaine, l’Europe est confrontée aujourd’hui à une forte concurrence et un risque avéré de déclassement. Si elle veut pouvoir garder son statut de puissance spatiale, elle doit à présent se donner les moyens de son ambition et « allumer ses boosters » en matière d’investissements, de gouvernance des programmes, et de cohérence des politiques institutionnelles et industrielles pour une performance opérationnelle et économique accrue au niveau mondial. Lire la suite
Les pertes d’hélicoptères russes au début de l’« Opération militaire spéciale » en Ukraine ont questionné les prévisions d’investissements consacrés au segment aéromobile. Une telle interrogation n’est pas nouvelle et trouve une perspective intéressante dans les différentes ères stratégiques qui ont caractérisé l’emploi de l’hélicoptère. Si ce dernier reste central dans une grande variété de missions, son adaptation à la conflictualité future gagnerait à une approche capacitaire renouvelée par les sphères politiques, militaires, sociétales et industrielles. Cette approche pourrait utilement décliner la volonté européenne de réarmement autour de la Résilience, l’évolutivité, l’agrégation de partenaires, la culture du risque et la massification (REARM). Lire la suite
L’histoire de la guerre révèle, comme de nombreux rapports récents, les lacunes capacitaires françaises dans le domaine de la mobilité aérienne stratégique, en particulier sur le segment « hors gabarit » et la logistique. Celles-ci fragilisent la tenue de nos contrats opérationnels. Le contexte géopolitique actuel rend pourtant cette mission incontournable pour défendre nos intérêts, protéger nos ressortissants et renforcer la politique d’influence de la France. Le réveil stratégique européen doit être saisi pour développer en coopération des capacités aériennes « hors gabarit » et améliorer le volet logistique. Enfin, la remise en lumière de la résilience nationale pourrait épauler l’engagement des armées dans des crises ou guerres plus probables. Lire la suite
Les armées face aux défis capacitaires de demain
À l’approche de l’ère du transhumanisme qui pourrait débuter dès 2040, « pourquoi la guerre » est une question qui doit se reposer avec vigueur. Avec un être humain modifié, les causes profondes de la violence semblent se déplacer sans s’éteindre. Cette étude explore deux futurs probables : paix algorithmique ou guerre entre espèces. En sondant les racines anthropologiques de la conflictualité, elle montre que la mutation de l’homme bouleverse les fondements et les ressorts de l’emploi de la force armée. Devant ces ruptures à venir qui soulèvent des problèmes éthiques profonds, elle appelle à tracer sans naïveté une stratégie française ambitieuse à initier dès à présent. Lire la suite
Les progrès technologiques des trois dernières décennies ont permis des avancées majeures dans le domaine de l’augmentation du soldat permettant de passer du fantasme à la réalité. Il convient de s’attacher à la manière dont l’homme, et plus particulièrement le soldat, s’intègre dans cet environnement de plus en plus complexe. Le soldat plongé dans un environnement de haute technologie risque de plus en plus d’être limité par le phénomène de surcharge cognitive. Ainsi, le soldat augmenté apparaît comme une nécessité mais pose la question centrale de la place de l’humain dans cet environnement. Dans ce contexte, les sciences cognitives peuvent être un apport fondamental au travers de la densification de l’être tout en préservant le triptyque essentiel Corps-Esprit-Âme. Lire la suite
Le cyberespace s’est imposé comme un nouvel « état de nature » dont émergent des risques d’une ampleur inédite mais dont la portée est encore trop souvent sous-estimée. Hier « simple » ligne de défense technique, la cyberdéfense s’est érigée pour les États au rang d’attribut et de condition de puissance. Face au défi posé et fortes d’un socle capacitaire déjà solide, les armées françaises doivent développer et assumer une vision stratégique du domaine. L’objectif est à portée de main. Sa réalisation passera par une vision doctrinale renouvelée, la mobilisation d’une véritable ambition RH et la définition d’une organisation intégrant plus encore l’ensemble des acteurs, publics comme privés. Lire la suite
Les conséquences de la seconde révolution quantique alliées aux capacités offertes par l’Intelligence artificielle (IA) vont être majeures et concerneront de nombreux domaines à commencer par l’économie et la défense. La France, qui dispose sans conteste d’atouts indéniables, a réalisé depuis quelques années une vraie prise de conscience en se dotant d’une ambitieuse stratégie nationale pour le quantique. Cet article analyse le chemin parcouru, le reste à faire et formule quelques propositions pour rester dans la course. La création de fonds d’investissement privés dédiés ainsi qu’une fédération des efforts par l’Union européenne en font partie. Lire la suite
L’Intelligence artificielle (IA) a franchi une étape en 2022 en permettant de générer aisément des contenus de plus en plus réalistes rendant difficile de faire la différence entre le généré et l’authentique. Au-delà des perspectives positives identifiées dans divers domaines, cette évolution peut être employée au service de délinquants pour développer leurs activités criminelles. Elle peut également avoir un impact considérable sur notre relation à la preuve numérique dont la falsification pourrait être facilitée par l’IA. Si nous n’y prenons pas garde, il est à craindre pour la confiance dans notre système judiciaire et in fine dans nos sociétés établies sur le droit. Lire la suite
Grâce à l’intelligence artificielle et aux nanotechnologies, les biotechnologies vont considérablement se développer dans les années qui viennent, pour le meilleur et pour le pire. La bio-révolution va s’inviter dans de nombreux domaines de la vie de nos sociétés, y compris celui de la défense et de la sécurité. Si les biotechnologies portent de grands espoirs de l’humanité, leur caractère dual et leur militarisation lui posent également de grands défis. Une compétition acharnée est lancée entre les États-Unis et la Chine pour obtenir l’avantage stratégique qui manquera à l’Europe si elle reste la spectatrice naïve et inutile de cette course à la nouvelle bombe. Lire la suite
Dans un monde digitalisé et interconnecté où la cyberguerre, l’autonomie des systèmes et la guerre hybride prennent une place grandissante, la puissance militaire distribuée offre des opportunités inédites et soulève de nouveaux défis. Elle constitue un facteur de supériorité opérationnelle important face aux nouvelles menaces, en particulier pour les puissances occidentales aux formats d’armées sous-critiques qui peuvent ainsi maximiser le rendement de leurs systèmes d’armes au travers de logiques collaboratives. Elle représente in fine une évolution importante dans la conduite de la guerre, mais une évolution en cours et inachevée au regard des défis technologiques mais surtout organisationnels, doctrinaux et culturels. Lire la suite
Les enjeux du futur format des armées
Face à un environnement stratégique dégradé marqué par le retour de logiques de puissance et dans un contexte où les priorités budgétaires sont concurrentes, la France vise une augmentation de ses dépenses de défense. Les capacités militaires sont à renforcer et l’ensemble des pays européens prennent conscience de l’effort collectif nécessaire. Afin de répondre à ce besoin de réarmement, l’économie et l’industrie de défense doivent se mobiliser pour accroître la production. Cela implique des solutions budgétaires innovantes pour injecter des financements supplémentaires. En France, plusieurs acteurs publics et privés se mobilisent déjà pour accompagner cette montée en puissance et garantir l’autonomie stratégique nationale et européenne. Lire la suite
À l’heure du retour de la guerre en Europe, le Service du commissariat des armées (SCA) ouvre un nouveau chapitre de sa transformation. Construit pour les engagements expéditionnaires dans un contexte de rationalisation des soutiens, le SCA doit désormais se préparer à soutenir un conflit de haute intensité, dans la durée. Meilleure intégration à la manœuvre, durcissement opérationnel, résilience nationale sont au cœur de son projet, en cohérence avec les ambitions de la LPM 2024-2030. Mais gagner en endurance, au-delà des ressources supplémentaires nécessaires, suppose une mobilisation élargie de l’ensemble de la Nation. Lire la suite
Le premier Secrétaire général de l’administration (SGA) du ministère des Armées, Bernard Tricot, préconisait en 1971 une plus grande subsidiarité et simplification dans l’organisation budgétaire des armées. Cinquante ans plus tard, ce défi, pris en compte au plus haut niveau de l’État, est toujours d’actualité, après les réformes d’interamisation, de ministérialisation et de rationalisation fonctionnelle mises en œuvre à partir des années 2000. Reflet des choix opérés dans la répartition des responsabilités politico-administratives, l’architecture budgétaire du ministère des Armées mériterait d’être recentrée sur la finalité opérationnelle des dépenses de fonctionnement, afin de garantir une meilleure réactivité et efficacité face aux enjeux de conflictualité. Lire la suite
Si l’arrivée à maturité de l’exploitation de l’Intelligence artificielle (IA) au sein d’une Marine progressivement « data-centrée » va considérablement accélérer le développement des drones, elle va aussi va engendrer une profonde transformation des métiers opérationnels : pour être performant, chaque marin devra devenir un spécialiste de la manipulation de la donnée dans son domaine de spécialité. Les marins embarqués étant libérés d’une grande partie des tâches d’exploitation et de mise en œuvre des équipements, l’organisation des bâtiments de combat devra être repensée. L’ampleur du changement dépendra de la place laissée à l’homme dans une boucle décisionnelle que l’on cherche constamment à accélérer pour gagner au combat. Lire la suite
Le dispositif de formation des militaires doit s’adapter pour intégrer autant les aspirations et évolutions des militaires, que les spécificités du contexte dans lequel ils sont appelés à intervenir. Afin d’être plus performant, le système de formation militaire doit privilégier une approche plus modulable, pratique et alternée, ce qui peut être facilité par un rapprochement entre l’école et le terrain. Cette proposition de réforme doit s’accompagner d’une consolidation des méthodes pédagogiques et d’une adaptation des contenus de formation, en exploitant habilement les nouvelles technologies. Cela permettra d’ajuster le rythme de la formation à celui des opérations, et de préparer efficacement les militaires à tous types de conflits. Lire la suite
Quelques perspectives vues par nos alliés
Depuis 15 ans, les relations militaires France-Royaume-Uni ont été encadrées par les accords de Lancaster House. Cet article propose une analyse maritime des perspectives pour une relance de ces accords attendus en été 2025. Il retrace les succès passés, notamment en matière de dissuasion nucléaire, d’équipements militaires communs et d’interopérabilité. Malgré des tensions (Brexit, AUKUS et rivalités industrielles), il souligne la nécessité d’approfondir la coopération face aux menaces actuelles. Trois priorités émergent pour les marines : le partage sécurisé d’informations, la coordination des groupes aéronavals, et le renforcement du réseau d’échange d’officiers. L’ambition est claire : les deux puissances maritimes européennes plus forte et intégrée. Lire la suite
Créée le 28 mai 1975, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), composée de 15 pays, est traversée depuis plusieurs décennies par des conflits et crises multiformes liés à la mauvaise gouvernance, au terrorisme et aux différents trafics. En dépit des avancées significatives obtenues, la région peine encore à sortir de l’insécurité et de la pauvreté. Pire, l’instance régionale a connu le retrait de trois de ses États que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont créé l’Alliance des États du Sahel (AES), aggravant ainsi l’insécurité. Des réformes majeures sont nécessaires dans des domaines très diversifiés et ont besoin d’être appuyées par les partenaires pour amorcer le décollage de la région, très riche en ressources. Lire la suite
Le Plan Mattei représente la stratégie de l’Italie pour redéfinir sa présence en Méditerranée élargie et en Afrique, en promouvant une coopération basée sur des partenariats équitables et durables, sans lien avec les logiques néocoloniales. Inspirée par Enrico Mattei, industriel et homme politique italien, cette initiative se concentre sur six secteurs prioritaires : énergie, agriculture, eau, santé, éducation et infrastructures, afin de répondre aux enjeux du développement économique, de la sécurité énergétique et des dynamiques migratoires. Cependant, malgré des objectifs clairs et des premiers résultats tangibles, des questions persistent concernant la gouvernance, le financement et la capacité du plan à rivaliser avec d’autres grandes stratégies internationales en Afrique. Lire la suite
La coopération militaire entre la France et le Qatar, établie depuis les années 1990, repose sur des accords de défense, des ventes d’armement stratégiques et des formations conjointes. Elle s’étend à la sécurisation d’événements internationaux majeurs, comme la Coupe du monde 2022 et les Jeux olympiques de Paris 2024. Des transferts de technologies et des projets industriels communs renforcent également cette alliance. Sur le plan diplomatique, les deux pays collaborent dans des forums multilatéraux pour promouvoir la stabilité régionale. Le Qatar, en modernisant ses forces avec l’appui français, affirme son rôle d’acteur sécuritaire du Golfe. Ce partenariat incarne une relation durable, équilibrée et tournée vers l’innovation stratégique. Lire la suite
Les alliés de l’Allemagne posent souvent la question pourquoi la Bundeswehr ne se voit pas en continuation de l’histoire militaire nationale, comme en France, car les militaires ont besoin d’éléments culturels et émotionnels qui leur permettent de s’identifier avec l’organisation. Or, la tradition de la Bundeswehr a été développée pour marquer la rupture avec la Wehrmacht et pour rendre plus efficace les nouvelles armées allemandes. À ces fins, on a décidé d’examiner l’intégralité de l’histoire militaire et de garder seulement ce qui correspond aux principes constitutionnels. Cette tradition est soumise à une dynamique sociétale et politique. Elle ne cesse de se développer, avec une partie croissante de l’histoire contemporaine et actuelle de la Bundeswehr.






_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)

